9 598 095 km²
République socialiste
Capitale : Pékin[1]
Monnaie : yuan (ou renminbi)
1,41 milliard de Chinois
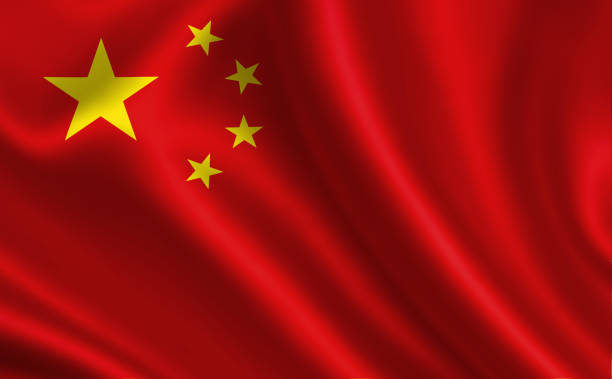
[1] La ville la plus peuplée est Shanghai.

Quatrième pays le plus vaste du monde, la Chine populaire possède les plus longues frontières terrestres de la planète : plus de 22 700 km. Elles concernent quatorze pays (record de voisins partagé avec la Russie).
Ce sont le Vietnam (1 280 km), le Laos (un peu plus de 420 km) et la Birmanie (près de 2 200 km) vers le sud, le Bhoutan (470 km), le Népal (près de 1 240 km), l’Inde (3 380 km), le Pakistan (un peu plus de 520 km), l’Afghanistan (76 km), le Tadjikistan (un peu plus de 410 km), le Kirghizistan (près de 860 km) et le Kazakhstan (plus de 1 530 km) en direction de l’ouest, la Mongolie (plus de 4 670 km) et la Russie (un peu moins de 3 650 km) au nord, la Corée du Nord (un peu moins de 1 420 km) au nord-est. Elle possède également des frontières maritimes avec la Corée du Sud, le Japon, les Philippines et la Chine nationaliste (Taïwan), le long de la mer de Bohai, de la mer Jaune et des mers de Chine orientale et méridionale (du nord au sud). Outre les quatre-vingt dix îles de Taïwan, considérée comme la vingt-troisième province chinoise, Pékin revendique la totalité de la mer de Chine méridionale, ainsi que l’archipel japonais des Senkaku (situé entre Taïwan et Okinawa). Sur terre, Pékin dispute à l’Inde de nombreuses zones montagneuses, limitrophes de ses régions du Xinjiang et du Tibet. Occupant plusieurs milliers de km² dans le Ladakh indien (l’Aksai Chin), la Chine revendique aussi l’État d’Arunachal Pradesh (qualifié de « Tibet du sud »), membre de l’Union indienne ; dans cette même région du centre-est himalayen, elle ne reconnaît pas l’intégration du Sikkim à l’Inde et prétend au plateau bhoutanais du Doklam (cf. Deux géants face-à-face). Il lui arrive même, parfois, de contester à la Russie une partie de leur frontière, pourtant arrêtée, sur les rivières Amour et Oussouri.
Pour la géographie physique, cf. Monde sino-mongol.
A la différence de Sun-Yat-Sen qui avait promu l’idée, datant du XIXe siècle, des « cinq peuples de la Chine » (Han, Mandchous, Mongols, Tibétains et « Hui » employé comme terme générique des musulmans), les communistes ont réparti la population chinoise en cinquante-six « nationalités » (Minzu), définies sur des critères ethniques, voire culturels et religieux. Dérivé du dialecte pékinois, le mandarin s’est imposé comme « lingua franca » au début du XXe siècle : il est désigné comme putonghua, c’est-à-dire langue commune, écrite et enseignée dans tout le pays et même adoptée par certaines minorités ayant perdu leur propre idiome.
L’ethnie de loin la plus nombreuse est celle des Han ; avec les Hui (musulmans sinisés, répartis dans l’ouest et le centre du pays), ils n’occupent que 40 % du territoire mais représentent plus de 90 % de la population. Plus de 930 millions d’entre eux ont le mandarin comme langue maternelle. Les autres 300 millions (présents essentiellement dans les provinces du sud-est) parlent sept langues, aussi différentes entre elles que le français et l’italien (sans compter les variantes et prononciations locales) : le wu (100 millions de locuteurs à Shanghai et dans le Zhejiang), le cantonais ou yué (70 millions dans le Guangdong et l’est du Guangxi), le hakka ou kejia (40 millions, à cheval sur Jiangxi et Guangdong), le xiang (50 millions à Hunan), le gan (25 millions dans le Jiangxi) et cinq parlers min aussi distincts entre eux qu’ils le sont des autres (50 millions, dans le Fujian ainsi que dans les îles de Hainan et Taïwan).
Les cinquante-cinq autres ethnies (shaoshu minzu, « peuples peu nombreux ») parlent presque autant de langues, dont près de la moitié sont écrites (dans autant de systèmes d’écriture). Elles sont réparties en six familles :
– Tibéto-birmane : plus de 26 millions, dont 8 millions de Tujias (centre), près de 8 millions de Yi[1], environ 6 millions de Tibétains et 1,9 M de Bai.
– Altaïque (environ 30 millions) : 11 millions de Mandchous (de langue chinoise[2]), une dizaine de millions de turcophones (plus de 8 millions de Ouïghours et 2 millions de Kazakhs au Xinjiang), un peu moins de 6 millions de Mongols, 2 millions de Coréens (à la frontière avec la Corée du nord).
– Taï-Kadaï : environ 26 millions (dont plus de 16 millions de Zhuang) au sud.
– Miao-Yao : une douzaine de millions (Hmong 9 millions, Yao ou Mien 2,6 millions…) dans le sud.
– quelques dizaines de milliers de locuteurs de langues austro-asiatiques (Môn-Khmer, Vietnamiens) ou indo-européennes (comme le tadjik pamirien, héritier des langues iraniennes orientales de l’Antiquité). S’y ajoute la nationalité « Gaoshan », terme générique utilisé pour qualifier les langues austronésiennes, dites formosanes, parlées par les autochtones de Taïwan (considéré comme partie intégrante de la Chine).
Plus de trente millions de Chinois vivent également hors de Chine. Originaire à 90 % de trois provinces méridionales (Guangdong, Fujian et Hainan), cette diaspora est majoritairement de langue cantonaise, hokkien ou hakka. Les « Chinois d’outre-mer » sont plus de cinq millions en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, plus de deux millions à Singapour et au Vietnam. Ils sont également présents en Russie, Birmanie, Philippines, États-Unis…
Cinq régions autonomes (RA), couvrant 45 % du territoire mais ne disposant d’aucun pouvoir politique réel, ont été instituées pour les minorités les plus nombreuses : la Mongolie intérieure (1,1 M de km²) créée dès 1947 dans les territoires communistes pour les Mongols, le Xinjiang (1,6 M de km²) fondé en 1955 pour les Ouïghours, le Ningxia (66 400 km²) en 1957 pour les Hui, le Guangxi (236 000 km²) en 1958 pour les Zhuang et le Tibet (1,2 million de km²) en 1965 pour les Tibétains. A un échelon administratif inférieur, des préfectures ou des districts (yuan) autonomes ont été attribués à des minorités de moindre importance numérique (par exemple celle de Dali pour les Bai, d’Ili pour les Kazakhs du Xinjiang et de Yanbian pour les Coréens) ou encore à des Mongols ou des Tibétains habitant à l’extérieur de leurs Régions autonomes. En pratique, quasiment aucun de ces peuples n’est majoritaire dans « sa » zone autonome, à l’exception des Tibétains de la RA du Tibet[3].
En matière de religion, la Chine ne les recense pas et ne publie pas de statistiques. Elle reconnait un statut officiel à cinq cultes (ce qui n’interdit pas au régime de poursuivre périodiquement leurs pratiquants) : taoïsme, bouddhisme, islam, protestantisme et catholicisme. Les religions populaires ou nouvelles ne sont pas identifiées clairement, de même que les différences de courants existant au sein du bouddhisme, de l’islam ou du protestantisme. L’adhésion exclusive à un culte donné n’étant pas exigée dans les religions prédominantes (bouddhisme, taoïsme et religion traditionnelle chinoise), leurs pratiquants peuvent mêler les pratiques et fréquenter plusieurs lieux de culte : ils peuvent ainsi se présenter comme appartenant indifféremment à l’une ou l’autre des religions ou bien aux nouveaux mouvements, la plupart du temps syncrétiques, apparus à partir du XIXème siècle, voire se déclarer confucianistes. Selon les évaluations, entre 69 % et 83 % des Chinois seraient adeptes des religions traditionnelles (taoïsme inclus pour un peu plus de 10 %), entre 7 % et 14 % seraient bouddhistes (lamaïstes au Tibet et en Mongolie, école Mahayana ailleurs, cf. L’Inde creuset de religions), environ 2,5 % chrétiens (majoritairement protestants) et moins de 2 % musulmans (essentiellement sunnites : c’est le cas des Hui, des Ouïghours et autres turcophones du Xinjiang, ainsi que de peuples divers comme les Utsuls de Hainan, descendants des réfugiés Cham).
[1] Descendants du peuple antique des Qiang, comme les actuels Tibétains, Naxi et Qiang, les Yi ont émigré du sud-est du Tibet au Sichuan et au Yunnan.
[2] La langue mandchoue reste en revanche parlée par les Xibe, descendants de colons mandchous établis au Xinjiang.
[3] Selon le recensement de 2010, la minorité ethnique tibétaine comptait 2,7 millions de membres dans la Région autonome, soit plus de 90 % de la population locale.
SOMMAIRE
- Les premiers pas du régime communiste
- Du « grand bond en avant » à l’annexion totale du Tibet
- Le chaos de la révolution culturelle
- La disparition de Mao et du maoïsme radical
- La nouvelle voie du communisme chinois : libéralisme économique et répression
- L’avènement d’une nouvelle génération
- La prise du pouvoir par Xi Jinping
- Un pouvoir sans partage
- ENCADRE : des dizaines de milliers d’incidents annuels
- ENCADRE : les soubresauts du séparatisme mongol
- ENCADRE : Une puissance de plus en plus puissante

Les premiers pas du régime communiste
Non reconnus par les Occidentaux, à l’exception de la Grande-Bretagne, les communistes sont en revanche majoritairement accueillis en libérateurs dans leur pays : ils sont en effet considérés comme des nationaux (à la différence des Mandchous ou des Mongols), ayant réussi à rétablir l’ordre dans une Chine réunifiée. L’Armée populaire ayant repris l’île méridionale de Hainan au Kuomintang, en mars 1950, seules les colonies de Hong-Kong et Macao et surtout Taïwan et ses dépendances (aux mains des nationalistes) échappent encore à la juridiction de Pékin (cf. Taïwan). Mêlant contrainte, répression ciblée et éducation, les nouveaux dirigeants mettent rapidement en œuvre leur programme. Le pilotage en revient aux chefs militaires des premières heures de la révolution, promus à la tête des dirigeants du pays. Dans le sud, ils engagent la réforme agraire déjà mise en œuvre au nord, quitte à éliminer physiquement les riches paysans qui s’y opposent (un à deux millions de morts). A l’automne 1950, les troupes communistes mettent fin à l’indépendance, largement fictive, du Tibet et pénètrent dans la province qui est de la plus haute importance stratégique pour Pékin, comme l’indique son nom chinois de Xizang (« réservoir de ressources naturelles de l’ouest ») : zone tampon avec l’Inde, elle est aussi le berceau des grands fleuves que sont le Yangzi, le Mékong et le Brahmapoutre. En mai 1951, l’Armée populaire (APL) est déployée à Lhassa, même si la Chine reconnait l’autonomie tibétaine, du moins formellement.
Sur la scène internationale, la Chine populaire reconnait la République démocratique du Nord Vietnam, proclamée par les Vietminh communistes, qu’elle va armer dès les mois suivants dans la lutte qu’ils mènent contre le sud Viet Nam et ses alliés occidentaux. En février 1950, Pékin signe un traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle avec l’URSS, en dépit de la méfiance que Mao et Staline nourrissent l’un envers l’autre. Entre autres dispositions, le traité reconnait l’appartenance de la Mandchourie à la Chine. La même année, Pékin commence l’envoi de plus de deux millions de « volontaires » aux côtés des nord-Coréens, engagés dans une guerre contre « l’impérialisme » américain et son allié de Corée du sud : 800 000 de ces combattants y perdront la vie, sans que le rapport de forces entre puissances ne soit modifié dans la péninsule. Plus discrète, l’aide des communistes chinois aux « frères » nationalistes du Vietminh s’avère plus concluante, puisqu’elle aboutit à la victoire de leurs protégés. Tout en restant tributaire de l’aide militaire et technique des Soviétiques, la Chine adopte une voie diplomatique propre qui en fait la championne de la lutte anticoloniale et un des acteurs majeurs du mouvement des non-alignés qui voit le jour en 1955 à Bandung (Indonésie).
Sur la scène intérieure, des opérations de masse – héritées du léninisme – sont menées dès 1951 contre tous les « contre-révolutionnaires » : intellectuels liés à l’ancien régime, religieux et membres des sociétés secrètes, bureaucrates corrompus, capitalistes divers… Contre l’avis de certains de ses conseillers, Mao accélère dans sa volonté d’instaurer une voie chinoise du communisme. Au milieu des années 1950, la collectivisation s’intensifie : les paysans sont enrôlés dans des équipes de production placées sous le contrôle direct de cadres locaux du Parti communiste (PCC). L’objectif est d’augmenter considérablement les revenus de l’agriculture – sans rémunérer davantage les ruraux – afin de financer le premier plan quinquennal (1953-1957) qui, avec l’aide de l’allié soviétique, privilégie le développement de l’industrie lourde. Celle-ci, ainsi que les commerces des villes, sont collectivisés début 1956. Au printemps 1956, le régime adopte un ton plus conciliant vis-à-vis de la liberté d’expression : il lance la campagne dite des Cent fleurs, destinée à favoriser l’éclosion de cent écoles de pensées. L’écho rencontré est tel – y compris sous la forme de critiques du PCC – que l’expérience s’achève brutalement en juin 1957. Elle est suivie d’un tour de vis qui se traduit par la déportation dans des camps de rééducation de plusieurs centaines de milliers de citadins et par le remplacement des bureaucrates qui avaient osé donner libre cours à leur parole.
Du « grand bond en avant » à l’annexion totale du Tibet
En 1957, la réforme agraire commençant à marquer le pas, Mao engage une nouvelle politique dite du « Grand bond en avant » qui va lui valoir le surnom de « Grand timonier » : des centaines de millions de paysans sont mobilisés, souvent sous forme de corvées, dans des actions massives de défrichement, de construction de digues et de travaux d’irrigation, ainsi que dans la création de petites industries locales. Le tout est supervisé par les dirigeants locaux du Parti qui rivalisent d’imagination pour s’attirer les louanges du pouvoir central : en 1959, les statistiques font état d’un doublement de la production, alors que les récoltes ont été mauvaises. Se fiant à ces résultats truqués, le pouvoir accentue ses réquisitions de produits agricoles, alors que l’industrie est également en crise : durant les « années noires » de 1959 à 1961, entre trente et quarante-cinq millions de Chinois meurent de malnutrition et de faim. Quand le ministre de la Défense, Peng Dehuai, dénonce le drame, il est évincé et remplacé par Lin Biao.
Dans le même temps, les relations avec l’URSS se sont considérablement dégradées : méfiant de longue date vis-à-vis de Moscou, Mao qualifie de « révisionnistes » les réformes engagées par le Président Khrouchtchev pour « déstaliniser » l’Union soviétique ; inversement, le numéro un soviétique raille l’échec du « Grand bond en avant » et dénonce les visées militaristes de Pékin qui envisage de s’emparer des îles de Quemoy et de Matsu, dépendant certes de la Chine nationaliste mais situées à quelques encâblures seulement de la côte du Fujian. La rupture entre les deux pays sera définitivement consommée en 1963.
Entretemps, au printemps 1959, la Chine a purement et simplement annexé le Tibet et provoqué le départ du dalaï-lama à Dharamsala, au nord de l’Inde (cf. Tibet). C’est là que, l’année suivante, le premier ministre indien autorise la formation d’un gouvernement tibétain en exil, ce qui contribue à accroître les tensions sino-indiennes. Un traité de coexistence pacifique a bien été signé en 1954 entre les deux pays, mais en laissant de côté la question de leurs 3 400 kilomètres de frontières communes. Or « l’omission » est loin d’être anodine quand on sait que le gouvernement chinois n’a jamais reconnu les lignes tracées à l’époque « coloniale » de l’Empire britannique des Indes, en particulier la « ligne Mac Mahon » délimitant sa frontière avec le Tibet (cf. Inde et Chine, deux géants face-à-face). En octobre 1962, 80 000 combattants de l’APL pénètrent en territoire indien, au Ladakh et au nord de l’Assam. Le mois suivant, Pékin proclame un cessez-le-feu unilatéral : conservant ses conquêtes du Ladakh sous le nom d’Aksai Chin, la Chine restitue en revanche les territoires assamais à l’Inde, tout en continuant à revendiquer les 90 000 km² de ce qui est aujourd’hui l’Etat indien de l’Arunachal Pradesh et que les Chinois appellent « Tibet du sud [1] ». En 1961, des troupes chinoises sont également intervenues en Birmanie : destiné à mettre fin à une rébellion menée par quelques reliquats du Kuomintang nationaliste, le déploiement de l’APL est aussi un moyen de remercier le régime de Rangoon qui, l’année précédente, a cédé trois zones frontalières de 560 km² à la Chine.
[1] C’est sous ce nom que cette région de peuplement tibéto-birman continue de figurer sur les cartes chinoises.

Le chaos de la révolution culturelle
Sur le plan économique, une nouvelle politique a été engagée au lendemain de l’échec cuisant du « Grand bond en avant » : s’appuyant sur les vingt millions d’ouvriers qualifiés que compte alors l’industrie et sur le retour des paysans à une agriculture moins collectivisée, elle est conduite par Deng Xiaoping, sous la houlette de Liu Shaoqi, élu Président de la République en avril 1959 à la place de Mao. Celui-ci doit de surcroit se livrer, début 1962, à une autocritique devant la direction du PCC, dont il a réussi à conserver la tête, et reconnaître son incompétence en matière économique. Mao va néanmoins reprendre progressivement le dessus sur les dirigeants du pays, accusés de routine bureaucratique et de révisionnisme, au motif qu’ils sacrifient l’idéologie sur l’autel du redressement économique. Fin 1962, Mao lance le mouvement d’éducation socialiste, visant à relancer le mouvement révolutionnaire dans les campagnes, tandis que Lin Biao diffuse dans l’Armée populaire le « petit livre rouge » de citations qu’il a réalisé (en 1964) à partir d’écrits du leader communiste.
Liu Shaoqi et une partie du PCC s’opposant à ses initiatives, le « Grand Timonier » accélère. En août 1966, il lance une « grande révolution culturelle prolétarienne », encadrée par son secrétaire Chen Boda et par ce qui sera appelé « la bande des quatre » : sa quatrième épouse, l’ancienne actrice Jiang Qing, et trois dirigeants de Shanghai. Pour mener à bien cette reconquête du pouvoir, Mao mobilise la jeunesse, en particulier les étudiants et les lycéens organisés en Gardes rouges. Multipliant les rassemblements de masse et s’exprimant par le biais d’affiches manuscrites (les dazibaos), ces jeunes activistes s’attaquent physiquement à tous ceux qui sont considérés comme « révisionnistes » et représentants des valeurs du passé : des cadres du parti, mais surtout les intellectuels et les créateurs. Dans leur ferveur révolutionnaire, ils saccagent des temples et des monuments, brûlent des livres anciens et détruisent des magasins liés à l’ordre ancien. Des milliers de dirigeants civils et militaires sont arrêtés, dont Liu Shaoqi qui meurt en détention en 1969. L’APL est par ailleurs mise à contribution pour « purger » l’ancien Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie-Intérieure, considéré comme « contre-révolutionnaire » et « séparatiste », puisque prônant le droit à l’autodétermination de la minorité mongole (cf. Encadré). Au moins 350 000 personnes sont arrêtées, dont un tiers est tué, blessé ou handicapé à vie.
Invités par le « centre » (la direction de la révolution culturelle) à remplacer les administrations en place, les Gardes rouges sont emportés par leur frénésie et ne tardent pas à se déchirer en factions rivales (souvent représentatives des différentes classes sociales dont ils sont issus). Ils se mettent aussi à revendiquer la totalité du pouvoir, contre les cadres du parti et les militaires avec lesquels ils sont censés le partager. Dans certains cas, les affrontements entre les activistes les plus radicaux et l’APL se déroulent à l’arme lourde : c’est le cas à l’été 1967 au Sichuan et à Wuhan. Les turbulences menaçant de dégénérer en guerre civile [1], Mao décide d’y mettre fin en janvier 1968 et de faire finalement appel à l’armée. Il ordonne à Lin Biao d’envoyer les Gardes rouges en rééducation dans les campagnes : dix-sept millions de jeunes vont connaître ce sort entre fin 1968 et 1980.
Devenue le support principal du régime, l’armée est également en première ligne au nord du pays, où l’animosité avec l’URSS dégénère en conflit ouvert lorsque, en mars 1969, des soldats chinois attaquent des gardes-frontières soviétiques sur la rivière Oussouri (affluent de l’Amour, Heilongjiang en chinois) et s’y emparent brièvement d’une île. Les combats reprennent cinq mois plus tard, cette fois le long de la frontière séparant les deux pays au Xinjiang. Après avoir frôlé un conflit nucléaire, les deux capitales signent finalement un cessez-le-feu en septembre, au terme de combats ayant fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts[2].
[1] La révolution culturelle » aurait fait entre un et cinq millions de morts.
[2] De nombreux historiens avancent le chiffre de 20 000 morts. Zhenbao (Damanski en russe) et une autre île seront finalement attribuées officiellement à Pékin en 2003. Depuis 1992, les Chinois ont également récupéré une bande de terrain (cédée en 1860) le long de la rivière Tumen, près de la frontière nord-coréenne.
La disparition de Mao et du maoïsme radical
Alors que la question de la succession de Mao (75 ans) commence à se poser, Lin Biao apparait en position de force : il est numéro deux du PCC, dont près de la moitié des membres du Comité central sont des militaires. De leur côté, les leaders de la révolution culturelle, réunis autour de Jiang Qing, n’ont pas renoncé à la relancer. Mais c’est sur Zhou Enlai que le « Grand timonier » s’appuie pour remettre en route l’administration chinoise. Soupçonné de préparer un coup d’Etat, Lin Biao meurt en 1971 dans un mystérieux accident d’avion en Mongolie, alors qu’il s’enfuyait en URSS. Sa disparition entraîne l’éviction de la moitié des militaires du Comité central et le ralliement de Mao à la ligne pragmatique incarnée par son Premier ministre, ce qui permet à Pékin de récupérer, en 1971, le siège de membre permanent de l’ONU qui était détenu par Taïwan. Quelques mois plus tard, en février 1972, le Président américain Nixon effectue une visite officielle en Chine. En août 1973, le Xème Congrès du PCC rappelle que, depuis 1927, le Parti « commande aux fusils ». Dans la foulée, Deng Xiaoping sort de sa disgrâce et retrouve sa place de vice-Premier ministre : c’est lui qui pilote les « quatre modernisations » (agriculture, industrie, science et défense) lancées par son mentor Zhou Enlai, peu de temps avant sa disparition en janvier 1976. Les guerres de clan étant loin d’être apaisées au sein de la direction chinoise, toute participation publique à ses obsèques est interdite. Mais ses partisans se rattrapent, par centaines de milliers, à l’occasion de la journée de commémoration des morts en avril suivant. La démonstration n’est pas du goût des leaders de la Révolution culturelle qui répriment ces manifestations et démettent Deng Xiaoping.
Le succès des maoïstes radicaux est de courte durée car Mao disparait en septembre. Dès le mois suivant, son successeur désigné Hua Guofeng fait arrêter la « bande des quatre [1] », tout en se présentant comme le continuateur du défunt. Officiellement, la « pensée Mao Zedong » reste, avec le marxisme-léninisme, le fondement de la politique du pays ; même les erreurs de la révolution culturelle ne sont pas vraiment portées au débit du leader disparu, mais davantage aux « gauchistes » qui l’entouraient. Mais, en pratique, une page se tourne. En juillet 1977, le nouveau chef du PCC doit se résoudre à rappeler Deng Xiaoping qui, en plus du poste de vice-Premier ministre, devient président de la puissante Commission des affaires militaires. Pour restaurer une image sévèrement dégradée et en finir définitivement avec la révolution culturelle, le Parti lance la politique du « Boluan Fanzheng [2] » : elle consiste notamment à réhabiliter des millions de victimes, y compris décédées, des différentes politiques mises en œuvre au cours des décennies précédentes. A la fin de l’année 1978, son promoteur Deng prend le contrôle effectif du PCC (donc du pays) même si, pour éviter les erreurs passées de concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme, Hua conserve quelques années des fonctions formelles à la tête du parti, du gouvernement et de l’armée.
Pour affirmer sa position, Deng Xiaoping annonce son intention de « donner une leçon » au Viêt Nam qui vient de provoquer la chute du régime cambodgien des Khmers rouges, allié de la Chine. En février 1979, des centaines de milliers de soldats chinois sont donc envoyés dans les provinces nord-vietnamiennes, mais les pertes qu’ils subissent sont telles que Pékin engage des négociations de paix dès début mars. Le bilan est également mitigé vis-à-vis de Taïwan : certes, les Etats-Unis ont reconnu, fin 1978, que « les Chinois de part et d’autre du détroit considèrent qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan (en) fait partie » ; mais le Taiwan Relations Act, voté par le Congrès américain en 1979, permet à Washington de poursuivre ses livraisons d’armes à l’île, afin qu’elle assure son autodéfense.
[1] Les leaders de la révolution culturelle sont condamnés pour complot en 1981 et emprisonnés. « L’impératrice rouge » Jiang Qing se suicide en cellule dix ans plus tard.
[2] Littéralement « éliminer le chaos et revenir à la normale ».

La nouvelle voie du communisme chinois : libéralisme économique et répression
Les succès sont plus probants sur le plan économique. Le nouveau pouvoir engage notamment une réforme agricole destinée à nourrir une population passée, en trois décennies, d’un peu plus de six cents millions d’habitants à près d’un milliard ; dans ce nouveau dispositif, les paysans s’engagent vis-à-vis de l’Etat à tenir des objectifs de production et conservent les surplus à leur profit. Le changement est plus difficile dans l’industrie : pour accélérer son développement, le régime ouvre la porte aux investissements étrangers dans quatre zones économiques spéciales, dont Shenzhen aux portes de Hong-Kong. Ces ouvertures se manifestent aussi dans le domaine culturel, où la réouverture des universités s’accompagne de critiques croissantes des étudiants à l’égard du monopole du parti. En mai 1989, des centaines de milliers de personnes se réunissent sur Tian’anmen, la grande place de Pékin où trône le mausolée de Mao, pour réclamer davantage de liberté, ainsi que la réhabilitation de Hu Yaobang, secrétaire général du PCC limogé deux ans plus tôt en raison de ses ambitions réformatrices. Après quelques tergiversations au sein de la direction du Parti entre libéraux et conservateurs, ces derniers envoient les chars pour reprendre le contrôle des lieux et de la situation. Plus d’un millier de personnes sont tuées dans la répression.
La même année, Jiang Zemin accède à la tête du PCC et Li Peng devient Premier ministre, mais la réalité du pouvoir continue d’être exercée par Den Xiaoping, jusqu’à sa mort en 1997. L’autorité revient alors à Jiang Zemin devenu Président de la République. C’est sous sa houlette que la Chine récupère Hong-Kong (colonie et « nouveaux territoires ») en 1997, en vertu d’un accord de restitution signé en 1984 avec Londres : celui stipule que l’ensemble (1 104 km²), devenu une place financière et portuaire majeure dans le monde, bénéficiera du statut de région administrative spéciale lui permettant de conserver son régime socio-politique durant cinquante ans (cf. Hong-Kong). Un statut identique est attribué à Macao (30 km²), restitué par les Portugais en 1999, dont l’économie est basée sur les jeux d’argent et le tourisme.
C’est aussi sous la direction de Jiang Zemin que le secteur des entreprises d’Etat (employant plus de 110 millions de personnes) est restructuré : si le mot de « privatisation » reste tabou et qu’il ne s’agit officiellement que « d’améliorer » le socialisme, cette politique de réformes touche l’ensemble du secteur public, militaire et bancaire compris. Elle se traduit par l’introduction d’un actionnariat interne, des regroupements d’entreprises, des « réinsertions » (transferts de personnels), des ouvertures aux capitaux privés et même des mises en faillite et des licenciements. Le clou est enfoncé par Zhu Rongji qui succède à Li Peng (élu à la tête de l’Assemblée) au printemps 1998 : protégé de Deng qui l’avait fait maire de Shanghai, le nouveau chef du gouvernement opère également une entreprise de séduction vis-à-vis de la communauté internationale, en libérant ses dissidents de notoriété internationale (y compris ceux qui avaient pu être tabassés en prison par des codétenus, en échange de réductions de peines).
Pékin signe aussi la convention internationale des droits civiques et politiques (garantissant liberté d’expression et de réunion, procès équitables, interdiction de la torture), tout en évoquant à l’ONU des modulations d’application prenant en compte « les conditions spécifiques des différents pays ». De fait, le régime ne lâche pas plus de lest que nécessaire : les peines de prison ou d’envoi en camps de rééducation tombent sur les membres les plus en vue du « Parti démocratique chinois » lancé en juin 1998, ainsi que sur un Shanghaïen ayant appelé à la création de syndicats libres. Les accusations « d’atteinte à la sûreté de l’Etat » valent également une peine de dix ans à un syndicaliste ayant donné à une radio occidentale des informations sur des troubles sociaux ayant fait une dizaine de morts, en avril 1998, dans le Hunan) : les émeutiers protestaient contre l’interdiction par le gouvernement des filières pyramidales de vente directe, Pékin redoutant notamment que ces pratiques entretiennent des comportements proches de ceux des « sectes ».
Des dizaines de milliers d’incidents annuels Les marges de la Chine ne sont pas les seules à être sujettes à des accès de violence. Au nombre de plusieurs dizaines de milliers par an, les « incidents de masse » (la terminologie officielle) ne contestent pas le régime en tant que tel, mais les agissements et la corruption d’un certain nombre de dirigeants locaux ce qui, in fine, permet au pouvoir central d'effectuer des purges régulières. Ces émeutes surviennent, notamment, à la suite de la confiscation de terres, au profit d’implantations énergétiques ou industrielles, parfois polluantes. Les violences sont d’autant plus importantes, dans le Guangdong et les autres provinces côtières développées, que les expropriés sont rarement embauchés par les nouvelles entreprises : celles-ci préfèrent employer une main d’œuvre, bien meilleur marché, venant des provinces pauvres de l’intérieur. La seule province de Guangdong compte trente millions de migrants intérieurs chinois, considérés comme des citoyens de seconde zone par les locaux qui contrôlent l’économie et l’ordre public. Beaucoup de zones sont aux mains de fonctionnaires corrompus, alliés à la police locale ou à des gangs mafieux. En septembre 2008, un jeune homme tue le responsable communiste d’un village du Shanxi : le défunt confisquait des parcelles de forêt dans lesquelles il abattait les arbres pour reclasser les terrains en vue d’implantations industrielles ; les villageois, propriétaires collectifs des forêts en droit, étaient dédommagés symboliquement et passés à tabac s’ils avaient la mauvaise idée de protester. En juin 2011, la police doit envoyer des blindés pour mettre fin à plusieurs jours de violences dans une ville proche de Canton, après qu’une milice municipale y a battu une jeune commerçante des rues, enceinte, originaire du Sichuan ; la semaine précédente, un scénario similaire s’était produit dans l’est du Guangdong, où un patron avait fait mutiler par ses hommes de main un jeune migrant du Sichuan qui lui réclamait des arriérés de salaires. La violence prend aussi la forme « d’attentats du ressentiment » commis par des citoyens s’estimant lésés par les administrations ou le gouvernement. En juin 2013, une quarantaine de personnes périssent dans un bus à bord duquel un homme, en conflit avec la police locale, s’immole par le feu. A l’automne 2015, le jour et la veille de la Fête nationale, l’explosion d’une quinzaine de colis piégés fait une demi-douzaine de morts dans divers lieux d’un district du Guangxi (hôpital, prison, gare, supermarché, centre du gouvernement local…). Pour mettre fin aux spoliations et émeutes, tout en stimulant la consommation intérieure, le pouvoir a instauré fin 2008 une réforme agraire qui donne aux paysans le droit de disposer de l’usage de leurs terres (y compris de les louer) ; jusqu’alors, ils possédaient un droit d’exploitation qu’ils ne pouvaient transférer, la propriété des terres appartenant aux Comités de village. Les violences peuvent aussi prendre un caractère ethnique, notamment de la part des Hui, descendants de commerçants arabes et persans arrivés en Chine à partir du VIIème siècle. Bien que très sinisés, ils se distinguent par leur confession musulmane et se méfient de l’hégémonie des Han. En décembre 2000, des émeutes éclatent dans le Shandong, après la "provocation" d'un boucher han annonçant la vente de "porc musulman". En octobre 2004, des émeutes font au moins sept morts (sans doute beaucoup plus) dans un district de la province du Henan, après la mort d’une fillette han renversée par un chauffeur de taxi hui. En juin 2023, les rumeurs de destruction d'une mosquée datant de l'époque Ming provoque des heurts entre les Hui et les forces de l'ordre dans une préfecture du Yunnan.
La lutte contre les malversations financières et la délinquance en général se renforce en effet dans la seconde moitié des années 1990, avec le lancement de la campagne « frapper fort contre la criminalité » qui touche les auteurs de petits larcins comme les criminels endurcis et les délinquants en cols blancs, notamment quand il s’agit d’adversaires politiques. En juillet 1998, seize ans de prison sont prononcés, pour versement de pots de vin et détournement de fonds publics, contre l’homme fort de Pékin, Chen Xitong qui, après avoir essayé de conquérir la tête du PCC contre Jiang Zemin, s’était érigé en chantre d’une « remaoïsation » du pays. Selon le très officiel Quotidien du Peuple, la corruption et les trafics touchent toute la société, armée comprise : l’Asian Wall Street Journal affirme par exemple que des sociétés contrôlées par les militaires achètent des sommes importantes de dollars pour spéculer contre le yuan, alors que le gouvernement s’efforce de maintenir la parité de la monnaie nationale. La seule année 1999, 132 000 officiels sont sanctionnés (dont dix-sept ayant rang de ministre), ce qui n’empêche pas les malversations de se poursuivre : ainsi, 600 millions de dollars (soit 10 % des sommes prévues pour reloger les populations déplacées par la construction du gigantesque barrage des Trois Gorges) auraient disparu dans des poches privées.

L’avènement d’une nouvelle génération
Contre toute attente, ce n’est pas sur le terrain politique ou social que se déroule la plus importante manifestation enregistrée depuis les événements de Tian’anmen, mais sur le terrain religieux : en avril 1999, plus de 10 000 personnes, silencieuses, réclament en plein cœur de Pékin la fin des persécutions de l’Etat à l’encontre de leur foi appelée Fa Lun Gong. Fondée en 1992 par un ancien militaire réfugié aux Etats-Unis, la « Société de la loi rotative » – allusion à la « roue de la loi » bouddhique – revendique près de quatre-vingts millions de membres (soit vingt de plus que le PCC) : par son mélange de mystique, de gymnastique et d’arts martiaux, de refus des valeurs matérielles et de la science, elle s’est imposée dans les classes populaires, et même dans l’appareil du Parti, en bénéficiant du recul de l’idéologie maoïste et du retour en grâce des croyances traditionnelles ; dès la fin des années 1950, les élites elles-mêmes avaient promu le « travail du souffle » (qi gong), hérité du taoïsme, en opposition à la médecine « bourgeoise » occidentale. Mais Fa Lun Gong s’apparente tellement, par sa doctrine messianique et apocalyptique, aux grandes « sociétés secrètes » du passé (Taiping, puis Boxers) que le régime prend les devants : plus de trente-cinq mille personnes sont arrêtées et des centaines d’adhérents condamnés à des peines allant jusqu’à dix-huit ans de prison. Les sanctions englobent les membres d’autres sectes de la mouvance « qi gong », ainsi que d’Eglises chrétiennes non reconnues. Certains de ces détenus auraient même alimenté, contre leur gré, un trafic à grande échelle d’organes humains tels que des reins et des cornées [1].
Au-delà de cette poussée de fièvre religieuse, des mouvements sociaux violents se développent dans les secteurs les plus menacés par les réformes. Tandis que cent millions de Chinois (15 % des actifs) trouvent des emplois dans un secteur privé florissant dans les provinces côtières (Guangdong, Fujian, Zhejiang), trente millions d’autres sont au chômage. Début 2000, des manifestations de mineurs éclatent dans le Yunnan et le nord-est mandchou, suivies d’émeutes paysannes contre la collecte d’impôts à l’été suivant dans le Jiangsu. Selon une enquête officielle de 2006, la moyenne des revenus dans les zones urbaines est douze fois supérieure à celle des revenus les plus faibles, cet écart ayant triplé en dix ans. L’année suivante, la Banque mondiale estime à trois cents millions le nombre de Chinois « très pauvres ».
La politique économique en vigueur est néanmoins poursuivie par Hun Jintao, qui devient le plus jeune Secrétaire général du PCC (59 ans) fin 2002, puis Président de la République l’année suivante. Mais, alors que Zhu Rongji et Li Peng disparaissent du Comité central, Jiang Zemin conserve de nombreux rouages du pouvoir[2], comme Deng Xiaoping avant lui. Sur le plan idéologique, le seizième Congrès du Parti consacre un peu plus l’enterrement de la « lutte de classes » et l’alliance de l’élite issue de la Révolution de 1949 avec les nouvelles élites économiques : issue très largement des régions côtières les plus développées (Shandong et Jiangsu notamment), cette « quatrième génération » de dirigeants est la première à s’être forgée en Chine communiste, quand les trois précédentes avaient été formées à l’étranger et éduquées dans le cadre de la résistance anti-japonaise et de la guerre contre le Kuomintang nationaliste (Zhou Enlai et Deng) ou élevées dans le cadre de l’amitié sino-soviétique, avec passage dans les écoles et les usines du pays « frère » (Jiang Zemin, Li Peng).
Cette nouvelle alliance se concrétise par l’adoption d’une quatrième « idéologie directrice » (en plus du marxisme-léninisme, de « la pensée Mao Zedong » et de la « théorie de Deng Xiaoping ») : chère à Jiang Zemin (mais sans porter son nom), la « pensée des trois représentativités » fixe au PCC la mission de représenter « les forces productrices les plus avancées » (classes moyennes et entrepreneurs privés), « la culture la plus avancée » et « les intérêts de l’écrasante majorité du peuple chinois « . Constatant que de nouvelles « couches sociales » sont apparues à la faveur des réformes économiques et que le PCC n’est plus un parti révolutionnaire mais un parti de gouvernement, les résolutions adoptées au Congrès enterrent le « prolétariat » et font du Parti « le détachement d’avant-garde de la classe ouvrière en même temps que celui du peuple chinois et de la nation chinoise ». Y adhérer devint officiellement possible à « tout élément avancé d’autres couches sociales », en plus des ouvriers, des paysans, des militaires et des intellectuels. Cette évolution est confirmée en 2004 par la reconnaissance très officielle de la propriété privée : tout en maintenant un droit de réquisition par l’Etat au nom de « l’intérêt public » (en échange de « compensations »), le nouveau texte garantit le caractère « inviolable » de la « propriété privée légale des citoyens » : la phrase ne manque pas de piquant pour la trentaine de millions de paysans ayant perdu leurs terres du fait de l’urbanisation, entre 1987 et 2001.
[1] L’hypothèse est accréditée par l’augmentation du nombre de greffes (passé de 18 500 entre 1994 et 1999 à plus de 60 000 de 2000 à 2005) et par les délais très courts de fourniture d’organes que proposent les sites internet d’hôpitaux chinois.
[2] Jiang Zemin démissionne en 2004 de son dernier poste, celui de chef de la Commission militaire.
La prise du pouvoir par Xi Jinping
A l’approche du dix-huitième Congrès du PCC, les luttes de clan s’exacerbent : le ténor de l’aile gauche du Parti Communiste, Bo Xilai, est arrêté à l’automne 2012 pour avoir tenté d’étouffer l’assassinat, par son épouse, d’un conseiller britannique, sur fond de corruption. La femme et le frère du Premier ministre sortant, Wen Jiabao, se retrouvent également accusés d’avoir accumulé plus de deux milliards d’euros durant la gouvernance de leur parent, pourtant chantre de la lutte anti-corruption. Pourtant, en novembre, la direction du parti est conquise par Xi Jinping, dont une enquête de la presse occidentale avait estimé la fortune à trois cents millions d’euros. Fils d’un ancien vice-Premier ministre de Mao déchu sous la Révolution culturelle, il accède à la Présidence de la République en mars 2013, ainsi qu’à la direction de la Commission militaire centrale, à la place de Hu Jintao qui, dans son discours de départ, souligne que la corruption rampante pourrait mener le parti « vers sa propre perte ». A la tête d’un Comité du bureau politique largement renouvelé (par des « princes rouges », héritiers ou gendres de hauts dignitaires, ou par des membres de la « faction » de la Ligue des jeunes communistes), le nouveau numéro un chinois engage la lutte contre la corruption. Reprenant les termes d’une campagne lancée en 1951 par Mao, et dont son propre père avait été un des principaux opérateurs, il lance la chasse aux « tigres » (hauts dirigeants) et aux « mouches » (cadres subalternes), sur fond de règlements de comptes politiques. Au nom de la lutte contre l’islamisme radical, engagée au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai (cf. Encadré), il intensifie également la répression des populations musulmanes du Xinjiang (cf. Répression de masse au Xinjiang).
Fin 2013, le Comité central adopte un nouveau train de réformes socio-économiques, allant d’une meilleure réglementation du statut des travailleurs migrants (et du véritable « passeport intérieur » que constitue le hukou) à la suppression officielle des camps et prisons de rééducation par le travail (laojiao et laogai[1]), en passant par l’ouverture du capital de certaines entreprises publiques et par la réforme du statut de l’enfant unique : avoir un deuxième enfant devient possible, quand l’un des deux parents a été enfant unique[2]. Rien n’est lâché, en revanche, sur le plan politique, avec la création d’une Agence de sécurité intérieure. En pratique, le nouveau dirigeant – qui concentre tous les pouvoirs – oscille entre la revendication du plus pur héritage maoïste, révolution culturelle comprise (une statue de Mao en or et en jade est inaugurée à Shenzen) et l’appel aux traditions anciennes (le nom de Confucius est donné aux instituts chargés de promouvoir la culture chinoise dans le monde). En 2017, il sera le premier dirigeant communiste à recevoir un hôte étranger (en l’occurrence le Président américain) dans la Cité interdite des anciens Empereurs.
D’une manière générale, la société civile est largement remise au pas, en particulier sur le plan religieux : cela se traduit par le retrait de croix jugées trop ostentatoires aux portes d’églises et de temples protestants, mais aussi par la « désarabisation » de mosquées qui avaient été construites dans le Gansu et le Ningxia, dans les années 1990-2000, pour remplacer celles détruites pendant la révolution culturelle (leurs bulbes dorés et autres croissants de lune sont remplacés par des toits « à la chinoise ») ; cette politique s’applique aussi à la suppression de panneaux de rue en arabe, ainsi que de termes comme « halal » à la devanture de magasins. Dans son entreprise de consolidation de son pouvoir, Xi Jiping n’épargne pas l’institution militaire, dont d’anciens dirigeants sont condamnés pour corruption. Doté du nouveau titre de « commandant en chef », il entend ainsi mettre fin aux baronnies susceptibles de lui nuire, mais aussi de freiner sa volonté de moderniser les forces armées : de mieux en mieux équipées (cf. Encadré), celles-ci sont en effet mises au service d’une diplomatie agressive, dite des « loups combattants ».
[1] En pratique, ce système de détention existe encore, notamment au Xinjiang (cf. Encadré).
[2] La faculté existait déjà pour environ 30 % des couples (formés de deux enfants uniques ou bien appartenant aux minorités ou encore paysans ayant eu une fille).
Un pouvoir sans partage
En octobre 2017, Xi Jiping est réélu pour un mandat de cinq ans à la tête du PCC, entouré d’un Comité permanent du bureau politique dont ont disparu les héritiers de Hu Jintao. Surtout, sa « pensée » dans l’édification du « socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère » entre dans la charte du parti, privilège dont seul Mao avait bénéficié de son vivant [1]. Les quatre-vingt-dix millions de cadres et membres du Parti sont tenus de consulter régulièrement l’application « Etudier Xi, rendre le pays plus fort » et les journalistes n’obtiennent le renouvellement de leur carte de presse qu’après avoir passé avec succès un test sur cette pensée. Les organes du PCC, tels que le Département de la propagande, retrouvent la primauté qu’ils avaient perdue par rapport aux administrations d’Etat, qu’il s’agisse du contrôle de la culture, de celui des affaires ethniques et religieuses ou encore de la formation des fonctionnaires. En février 2018, la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels, introduite par Deng pour limiter le culte de la personnalité, disparaît. La décision, qui s’accompagne de la disparition de la limite d’âge de soixante-huit ans pour le dirigeant suprême, concorde avec la suppression de toute durée dans l’exercice du secrétariat général du Parti.
Une Commission nationale de supervision, super-ministère de la lutte contre la corruption, est également instituée, avec un pouvoir étendu à toute la fonction publique (et plus seulement aux membres du parti dont 1,5 million auraient déjà été exclus). En juillet 2020, une nouvelle campagne de purges aux accents maoïstes frappe les organes de sécurité et la justice. Son objectif est « d’éduquer et de rectifier les cadres », en particulier les « doubles faces » jugés trop peu loyaux, et de « gratter le poison jusqu’à l’os », en référence à la « campagne de rectification de Yan’an », menée par Mao dans les rangs du Parti entre 1942 et 1944. Les purges prennent à l’occasion un caractère régional, Xi Jiping privilégiant les cadres des régions dans lesquelles il a effectué son ascension (Fuijian et Zhejiang) ou dans laquelle il a grandi (le Shaanxi).
A l’automne, ce sont les géants de la « tech », dont la puissance commence à inquiéter le régime, qui sont repris en main. Alors que le poids des services a rejoint celui de l’industrie manufacturière, les dirigeants des entreprises de haute technologie sont accusés de tous les maux : fragilisation des banques publiques (« talon d’Achille » de l’économie chinoise) en incitant les Chinois à s’endetter, détention massive de données sur les consommateurs, pratiques oligopolistiques nuisant à l’innovation… L’encadrement de l’initiative privée par le PCC demeure en effet le dogme, avec pour objectif de favoriser le développement de la consommation intérieure et de poursuivre la croissance d’une économie qui a rattrapé celle des Etats-Unis : le PIB de la Chine est devenu le deuxième du monde, alors qu’il était sept fois inférieur, lors de son adhésion à l’OMC [2] en 2001. Deuxième détentrice de la dette américaine, la République populaire affiche un excédent commercial insolent vis-à-vis des Etats-Unis [3], avec lesquels a été engagée une guerre commerciale à outrance. En 2019, la Chine est le premier exportateur de biens de la planète (16 %, juste devant l’Union européenne) et le troisième importateur (13 % contre un peu moins de 14 % aux Européens et 16 % aux Américains). En outre, selon l’OMS [4], un Chinois vit désormais plus longtemps en bonne santé qu’un Américain.

Mais la société reste très inégalitaire : en 2020, le pays compte un millier de milliardaires – soit davantage que les États-Unis et l’Inde réunis – et 1 % de la population détient plus de 30 % de la richesse nationale, tandis que six cents millions de Chinois vivent avec moins de 1 000 yuans (130 euros) par mois et qu’un quart de la main d’œuvre est encore employée dans l’agriculture. Des dizaines de millions de coursiers, de chauffeurs de taxi ou de femmes de ménage travaillent par ailleurs comme « indépendants » avec une couverture sociale minimale, voire inexistante. En termes de PIB par habitant, le pays ne se situe d’ailleurs qu’aux alentours de la soixante-dixième place mondiale. Pour corriger la situation, le pouvoir engage en août 2021 une nouvelle politique, dite de « la prospérité commune », fondée sur l’appel à la générosité des plus riches (à commencer par les géants d’internet et les « élites rouges ») et sur des réformes fiscales [5], destinées à favoriser le développement des services publics.
Surtout, la population vieillit : au milieu du siècle, les plus de soixante ans devraient représenter plus du tiers de la population contre 18 % en 2020 (et 13 % dix ans plus tôt). La politique du deuxième enfant (et même du troisième, amorcée en 2021) n’a pas les effets escomptés : le nombre des naissances décroît année après année, tandis que l’espérance de vie augmente, avec toutes les conséquences que cela pourrait entrainer, depuis la baisse drastique de la population active jusqu’à l’explosion des dépenses médicales et sociales. En 2022, pour la première fois en soixante ans, le nombre de naissances s’avère inférieur à celui des décès, ce qui conforte l’hypothèse d’une diminution par deux de la population d’ici à 2100 et la crainte que la Chine « devienne vieille avant d’être devenue riche ».
En novembre 2021, le plénum du Comité central consacre le pouvoir de Xi Jinping, notamment à travers « un bilan historique des cent années de lutte du parti », troisième analyse du genre après celles de 1945 et 1981. Globalement clément avec Mao – à l’exception d’une nette critique de la révolution culturelle dont le père du numéro un chinois eut à souffrir – l’exercice est en revanche sévère avec la gestion de Deng Xiaoping : elle est décrite comme une « crise de foi politique » ayant favorisé la bureaucratie, la corruption, la recherche du plaisir et le goût du luxe, le népotisme et le clientélisme. Raisons pour laquelle le régime affirme vouloir intensifier sa politique de répression des « tigres », des « renards » et des « mouches » susceptibles de corrompre toute la société. En décembre, la police arrête le « roi des casinos » de Macao, accusé d’avoir monté des filières illégales pour permettre le blanchiment d’argent sale dans ses établissements, notamment celui des triades.
En octobre 2022, Xi Jiping est reconduit sans surprise pour un troisième mandat, à l’occasion du XXème Congrès du PCC. Son Premier ministre modéré et l’ancien Président Hu Jintao ayant été contraints de se retirer du Bureau permanent, celui n’est plus constitué que de fidèles, tous partisans d’une ligne nationaliste radicale, notamment vis-à-vis de Taïwan. A peine réélu, le numéro un chinois est contesté dans la rue, à Shanghai, Canton, Pékin, Nankin… Étudiants en tête, les manifestants réclament davantage de liberté, alors que plusieurs millions de Chinois sont confinés depuis des semaines, voire des mois, dans le cadre de la politique « zéro Covid » décrétée par le régime, afin d’enrayer la propagation d’un virus. L’application de cette stratégie prend un tour dramatique à Urumqi, capitale du Xinjiang : une dizaine de personnes meurt dans l’incendie d’un immeuble auquel les secours n’ont pu accéder, du fait des restrictions sanitaires. Celles-ci sont allégées dès le mois suivant, trop tard pour enrayer le ralentissement économique du pays : en 2022, le PIB chinois n’a progressé que de 3 %, le pire chiffre enregistré depuis 1976 (à l’exception de 2020, marquant le début de la pandémie).
En mars 2023, Xi Jiping conforte son pouvoir en se faisant réélire Président de la République à l’unanimité des parlementaires et en faisant nommer un de ses très proches au poste de Premier ministre : ex-Secrétaire du PCC de Shanghai, Li Qiang partage avec son mentor la volonté de renforcer le poids du Parti dans la vie sociale et économique du pays, en particulier dans la finance et la tech. Affaiblie par des sanctions américaines et par une situation internationale instable, l’économie chinoise stagne. En juillet, le chômage des jeunes dépasse le niveau record de 21 %. Pékin enregistre en revanche quelques succès diplomatiques, tels que le rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite (cf. infra) et l’entrée possible de ces deux « frères ennemis », et de quelques autres pays, au sein des Brics, le club des économies émergentes.
En décembre, le régime procède à une importante purge dans l’armée. Évincé sans explication en août, le ministre de la Défense est remplacé par le chef de la Marine, tandis que neuf responsables militaires sont exclus du Parlement ; parmi eux figurent quatre généraux d’une unité chargée des missiles stratégiques, unité dont la direction avait été changée en juillet, sur fond de corruption supposée. En mars 2024, l’Assemblée nationale populaire conforte la prééminence du parti sur le Conseil d’État (le gouvernement), en votant un amendement en vertu duquel le second se doit « d’appliquer résolument les décisions du comité central du PCC ». Le pouvoir a par ailleurs incité les PME à créer des sections du parti dès qu’elles comptent plus de trois salariés et invité les 98 millions d’adhérents à se réunir au moins une fois par an pour étudier la « pensée Xi Jinping ».
[1] Ce n’est qu’après la mort de Deng Xiaoping que sa « théorie », hiérarchiquement moindre qu’une pensée, avait été inscrite dans le corpus doctrinal du pays. C’est sous Deng qu’avait été théorisé le « socialisme à caractéristiques chinoises », selon lequel – vu son faible niveau de richesse matérielle – la Chine devait d’abord s’engager dans une croissance économique, pour atteindre une forme plus égalitaire de socialisme, qui conduirait in fine à une société communiste.
[2] Organisation mondiale du commerce.
[3] En 2018, les EU ont exporté pour moins de 120 Milliards $ vers la Chine qui leur a, en sens inverse, vendu pour plus de 540 Mds de produits (dont 130 dans l’électronique-informatique).
[4] Organisation mondiale de la santé.
[5] La Chine n’a ni impôt sur les successions, ni taxe foncière, impositions qui s’avèrent difficiles à mettre en place politiquement, compte-tenu de l’enrichissement très rapide de nombreux dirigeants et hauts fonctionnaires.
Les soubresauts du séparatisme mongol La situation est parfois tendue en Mongolie intérieure, vaste région de prairies, de déserts et de forêts, riche en métaux rares et en charbon. Représentant moins de 20 % de la population de la Région « autonome », les Mongols vivent parfois mal la domination des Han, arrivés en masse sous les Qing puis lors du « Grand bond en avant ». Plus nombreux que leurs cousins de Mongolie indépendante , ils se considèrent notamment comme les garants de l’écriture mongole, alors que leurs homologues nordistes écrivent encore leur langue en cyrillique. Durement réprimé pendant la Révolution culturelle, l’indépendantisme reste pourchassé et les arrestations se poursuivent dans les rangs des leaders séparatistes de « Mongolie du sud » (le nom donné à la Région chinoise par l’opposition en exil). A l’automne 2004, les Mongols se sont mobilisés contre l’attribution, par le gouvernement local, d’un mausolée consacré à Gengis Khan à un homme d’affaires han voulant en faire un complexe touristique. Sept ans plus tard, les heurts sont nés de la mort d’un berger, renversé par le camion d’un Han, alors qu’il tentait de bloquer un convoi de transport de charbon, dont l’exploitation se fait largement au détriment de l’élevage. En septembre 2020, les écoles et universités ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la politique menée par Pékin qui, au prétexte d’une politique de bilinguisme, veut imposer l’usage du mandarin dans la quasi-totalité des matières, dès l’enseignement primaire. L’agitation a été particulièrement importante dans la région orientale de Tongliao, une des plus anciennes colonisées par les Han, mais où les Mongols sont proportionnellement deux fois plus nombreux (45 %) que dans l’ensemble de la région autonome.
Une puissance de plus en plus puissante
Évincée de son rôle politique en 1997, l’armée n’en reste pas moins choyée par le pouvoir. Bien que toujours inférieur à celui des États-Unis, le budget militaire chinois – régulièrement sous-évalué – est devenu le deuxième du monde. Moindre que celui de Taïwan en 1995, lors de la « crise du détroit de Formose », il lui est désormais plus de quinze fois supérieur. Si la reconquête de l’île sécessionniste figure toujours en tête d’agenda, d’autres préoccupations ont pris une importance croissante, au fur et à mesure de la montée en puissance de l’économie chinoise : sous la houlette de sa faction la plus belliciste, dite des « loups combattants », la stratégie de Pékin est passée de la seule défense de son territoire à une protection de ses intérêts bien au-delà de ses frontières, à commencer par la zone Indo-Pacifique[1].
Parmi ces priorités figure la sécurisation des routes maritimes vers le Moyen-Orient, producteur majeur de pétrole dont la Chine populaire est le deuxième consommateur mondial. Pour protéger au mieux l’axe menant du détroit d’Ormuz à celui de Malacca, Pékin déploie une stratégie dite du « collier de perles » qui consiste à investir massivement dans des projets portuaires de plusieurs pays de l’Océan indien (souvent rivaux de l’Inde) : le Pakistan, le Sri Lanka, le Bengladesh, la Birmanie… Le cas échéant, ces infrastructures pourraient accueillir des navires de guerre. Au nom de la redécouverte de son espace maritime et de son statut passé de grande puissance navale (au XVème siècle), la Chine s’équipe de façon massive afin de se déployer dans toute la zone Asie-Pacifique, au-delà de la « première chaîne d’îles » pro-américaines voisines (Japon, Taïwan, Philippines, Bornéo). C’est notamment le sens des actions unilatérales qu’elle mène dans la très disputée mer de Chine méridionale. La situation est également tendue en Mer de Chine orientale, où des bateaux chinois se livrent à des incursions dans les eaux japonaises (eaux territoriales ou zone exclusive économique de deux cents miles, cf. Encadré dans l’article sur le Japon).
En quelques années, la marine de guerre chinoise est devenue la deuxième du monde : en 2020, elle aligne trois cent cinquante navires, soit une cinquantaine de plus que les États-Unis, sans disposer encore de capacités équivalentes, ni de la même expérience opérationnelle. C’est pour combler ce retard qu’elle coopère de plus en plus étroitement avec son homologue russe… jusqu’en Méditerranée. Fabriquant ses propres porte-avions (à propulsion classique), la Chine s’organise aussi pour disposer de bases de ravitaillement à travers le monde (la première à Djibouti en 2017), tout en augmentant les effectifs de ses « marines », aptes à mener des opérations à l’étranger.
Des dépenses massives sont effectuées dans tous les secteurs : bombe à neutrons (bombe réduisant les effets de souffle et de chaleur au profit des rayonnements neutroniques, plus préjudiciables aux populations qu’aux infrastructures), embarquement de missiles balistiques intercontinentaux à bord de sous-marins, fabrication de bateaux amphibies, accroissement de la furtivité de ses sous-marins nucléaires, développement d’un missile balistique « tueur de porte-avions », investissements dans les systèmes de défense spatiaux et les moyens de guerre électronique. En 2007, des « hackers » chinois, soupçonnés d’être téléguidés par l’Armée populaire chinoise, sont accusés d’avoir infiltré les systèmes informatiques de plusieurs États occidentaux. Depuis 1997, des attaques de ce type avaient déjà été menées contre des sites japonais, taïwanais, indonésiens (après les émeutes anti-chinoises de 1998) et américains (après le bombardement accidentel de l’ambassade chinoise de Serbie en 1999). En octobre 2019, à l’occasion du 70ème anniversaire de la proclamation de la RPC, Pékin exhibe ses nouveaux missiles balistiques intercontinentaux Dongfeng-41, d’une portée de 15 000 km, capables de porter plusieurs charges nucléaires et d’être lancés depuis des camions ou des silos enterrés (construits dans le Gansu). En août 2021, Pékin est suspecté d’avoir lancé un missile hypersonique (cinq fois la vitesse du son) à capacité nucléaire qui aurait fait le tour de la Terre en orbite basse, avant de descendre vers sa cible, ratée d’une trentaine de kilomètres.
Après des décennies de brouille, Pékin a renoué avec la Russie qui, à la suite des révolutions libérales survenues dans un certain nombre de pays de sa sphère d’influence historique (Géorgie, Ukraine…), a réorienté sa politique vers l’Asie centrale et orientale. Forte de son dynamisme économique, la Chine est devenue le premier marché de la technologie nucléaire civile et de l’industrie militaire russes ; elle est aussi un de ses premiers acheteurs de gaz et de pétrole. En juillet 2001, la visite de Jiang Zemin à Moscou se traduit par la signature d’un traité d’amitié pour vingt ans, incluant l’engagement de résoudre tous les désaccords exclusivement par des moyens pacifiques. Quatre ans plus tard, les armées des deux pays se livrent, à Vladivostok et dans la province maritime du Shandong, à des manœuvres conjointes qui vont se répéter les années suivantes. Elles s’inscrivent, en particulier, dans le renforcement de la coalition anti-terroriste (et anti-islamiste) que les deux nations ont créée, en 2001, avec quatre pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Kirghizstan) : l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). En 2005, Chinois et Russes délimitent les 2 % de leur frontière qui ne l’avaient pas encore été[2]. En 2018, sur fond de tensions persistantes avec les États-Unis, Pékin et Moscou annoncent qu’ils utiliseront davantage leurs monnaies nationales, et non le dollar, dans leurs échanges commerciaux croissants, combien même le poids économique des deux partenaires est disproportionné : le PIB chinois est près de dix fois supérieur au PIB russe et les échanges sont inégaux (Pékin est le deuxième partenaire de Moscou, loin derrière l’Union européenne, mais la Russie ne figure même pas parmi les quinze premiers partenaires de la Chine) ; en 2021, seules 16 % de leurs transactions s’effectuent en roubles et yuans, loin derrière celles en euros (47 %) et en dollars. La collaboration entre les deux pays va néanmoins croissante. Fin 2019, ils inaugurent le gazoduc « Power of Siberia », desservant le nord de la Chine depuis des champs gaziers situés en Sibérie russe, à 3 000 km de là. En février 2022, Xi Jinping et son homologue Poutine annoncent l’entrée de leurs relations « dans une nouvelle ère », marquées par une amitié « sans limite ».
Mais le plus grand projet du nouveau pouvoir pékinois est celui des « nouvelles routes de la soie ». En mai 2017, devant une trentaine de chefs d’État, la Chine lance en grandes pompes son projet pharaonique (144 milliards $), officiellement dénommé « One road, one belt » (Yidai yilu en chinois), puis « Belt and road initiative ». Maillant ports, autoroutes, chemins de fer, pipelines, il consiste en une route maritime allant jusqu’au Kenya et en Italie (via le canal de Suez) et en une ceinture terrestre de 11 000 km passant par l’Asie centrale, l’Iran, la Turquie et Moscou jusqu’en Allemagne, sans oublier l’axe routier de 2 000 km reliant le Xinjiang au port pakistanais de Gwadar. Du Panama à la Tanzanie, en passant par Le Pirée (dans une Grèce en situation de quasi-faillite), Pékin investit dans la construction et le financement de dizaines de terminaux portuaires (à vocation militaire éventuelle…) à travers le monde. Pékin séduit aussi l’ex-Europe de l’est communiste avec l’instauration, en 2012, d’un forum annuel dit « 16 + 1 ». L’aide accordée par la Chine à plusieurs dizaines de pays (plus de cent-soixante en deux décennies) représente 85 milliards de dollars en moyenne annuelle, soit deux fois celle des États-Unis et des autres grandes puissances[3]. Mais elle a ses revers, dans la mesure où elle est majoritairement constituée, non pas de dons mais de prêts, ce qui obère gravement les finances de certains pays tels que le Laos, le Sri Lanka et les Maldives. Les hommes politiques de quelques États n’hésitent d’ailleurs pas à comparer les conditions de ces aides aux « traités inégaux » que les Européens avaient infligés à la Chine au XIXème siècle. Dès 2018, le premier ministre malaisien met même Pékin en garde contre « une nouvelle version du colonialisme » : dans la foulée, il annule des projets pharaoniques signés par son prédécesseur dans des conditions peu transparentes. Des annulations surviennent aussi, par exemple au Népal, tandis que d’autres États – comme la Thaïlande et même les fidèles alliés pakistanais et birmans – renégocient leurs conditions de paiement.
En février 2023, un nouveau sujet de tension apparaît avec les États-Unis, du fait du survol de sites sensibles américains par un dirigeable chinois. Bien que Pékin ait présenté l’engin comme un ballon météorologique égaré, il est abattu par un avion de l’US Air Force. Taïwan affirme que des appareils similaires ont déjà survolé son « espace aérien supérieur » (HAO), zone qui n’est régulée par aucun texte international, à la différence de l’espace situé en dessous de 20 kilomètres d’altitude (régi par la Convention de Chicago de 1949) et de l’espace proprement dit, au-delà de 100 kilomètres (régi par un traité de 1967 sur l’extra-atmosphérique). Le même mois, Pékin publie son « initiative de sécurité mondiale », résolument multilatérale. La diplomatie chinoise en donne l’illustration dès le mois suivant sur la scène moyen-orientale : c’est depuis Pékin que l’Iran, solide allié de la Chine, et l’Arabie saoudite, désireuse de se dégager de la tutelle américaine, annoncent la reprise de leurs relations diplomatiques. En août, la Chine publie sa « carte nationale » qui mécontente tous ses voisins, de l’Inde à la Malaisie, en passant par le Vietnam et bien-sûr Taïwan ; elle inclut même les 300 km² de l’île de Bolchoï Oussouriisk, située au confluent de l’Amour et de l’Oussouri, alors que sa partie orientale est censée être russe, depuis un accord signé en 2004 avec Moscou.
Devenue la première du monde en nombre de bâtiments (mais pas en tonnage), la marine chinoise teste, en avril 2024, un nouveau porte-avions doté d’une catapulte électromagnétique, technologie que les Américains étaient jusqu’alors les seuls à maîtriser.
[1] Déploiement qui conduit le Vietnam et l’Inde à se rapprocher des États-Unis lesquels renforcent, en septembre 2021, leur coopération militaire dans la zone avec l’Australie et le Royaume-Uni.
[2] Longue d’environ 3 650 km, la frontière sino-russe met face-à-face des populations en nombre très inégal : moins de 8 millions de Russes depuis le Pacifique jusqu’à la frontière mongole, face à quelque 150 millions de Chinois.
[3] Rapport de l’Université américaine William and Mary (septembre 2021).







L’Océanie, peuplement et composition
Répression de masse au Xinjiang
Les relations inter-coréennes
Ukraine, chère indépendance
Israël et Palestine
Chine (République populaire)
Le Karabakh, « jardin » sanglant
Iran (et Perse)