377 930 km²
Monarchie constitutionnelle
Capitale : Tokyo
Monnaie : le yen
126 millions de Japonais
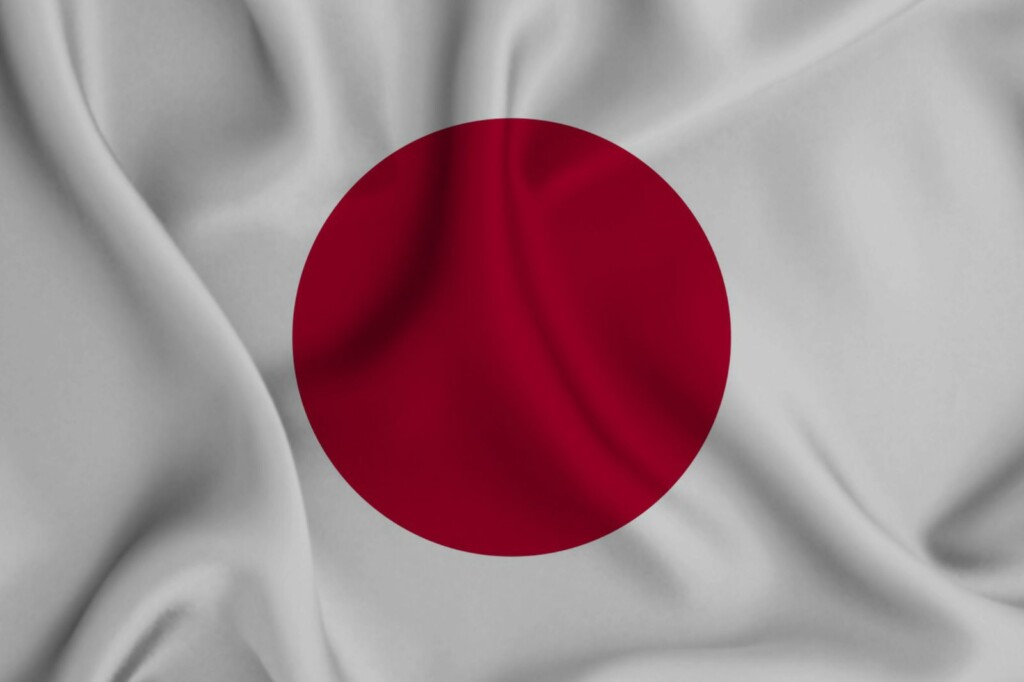

Archipel volcanique et fortement montagneux (un peu moins de 3 800 m au Mont Fuji), le « pays du soleil levant » (Nippon ou Nihon) est bordé par la mer de l’Est (ou mer du Japon) à l’ouest et par l’océan Pacifique à l’est. Il est distant d’un millier de kilomètres des côtes chinoises les plus proches et de 160 km des côtes de Corée du sud au détroit de Tshushima.
Ses îles principales sont d’une part Hokkaidō au nord et d’autre part Honshū (227 900 km²), Shikoku et Kyūshū, séparées par la Mer intérieure de Seto : reliées entre elles par des ponts, elles constituent le Hondo (la Grande-Terre). Les étroites plaines littorales du sud de Honshū et du nord de Shikoku et Kyūshū ne représentent que 6 % du territoire mais concentrent 80 % de la population. Appelé « Mégalopole japonaise » ou « ceinture du Pacifique » cet ensemble urbain réunit Tokyo, ainsi que les anciennes capitales de Kyoto et Nara et les métropoles d’Osaka, Yokohama, Nagoya… S’y ajoutent plus de 14 000 îlots et îles périphériques, dont un peu plus de quatre-cents habitées, en particulier celles des archipels Ogasawara (ex-îles Bonin au nord des Mariannes) et Nansai : s’étendant sur un millier de kilomètres du nord au sud, en direction de Taïwan, ce dernier est lui-même composé des archipels de Satsunan et des Ryūkyū (dont l’île principale, Okinawa, occupe 1 200 km²).
Le climat est continental dans la moitié nord et subtropical humide au sud, même si de fortes différences existent selon les côtes et le relief.

La population du pays est extrêmement homogène, composée à près de 98 % de Japonais, dont 2 % sont encore considérés comme des citoyens « de deuxième zone » : vivant dans quelque six-cents hameaux, les « Burakumin » descendent d’ancêtres pratiquant des métiers « impurs » comme tanneurs, croque-morts etc. Sont également discriminés les quelque 600 000 Coréens descendant, pour la plupart, d’émigrés arrivés dans le pays, de force ou non, lors de l’occupation de la péninsule coréenne par les Nippons. La société japonaise les considère toujours comme des étrangers, quelle que soit leur génération d’arrivée. S’y ajoutent 0,6 % de Chinois et 1 % d’autres étrangers (Vietnamiens, Philippins, Brésiliens), ainsi que deux minorités locales : quelque 300 000 Ryukyuans (soit 20 % des habitants de l’archipel des Ryūkyū, parlant des langues voisines du japonais) et les 25 000 à 200 000 Aïnous d’Hokkaido, locuteurs d’une langue isolée s’apparentant peut-être aux langues paléo-sibériennes (cf. Encadré)[1].
La plupart des Japonais ont une vision neutre de la religion et peuvent en pratiquer plusieurs simultanément, généralement le shintoïsme et le bouddhisme mahayana. Ainsi, en 2014, près des trois quarts de la population disaient suivre les rituels shintoïstes et les deux-tiers se déclaraient bouddhistes (cf. L’Inde creuset de religions). Les chrétiens sont moins de 2 %, en majorité protestants. Environ 7 % des Nippons sont adeptes des dizaines de milliers de « nouvelles religions » (shinshukyo) nées dans les années 1930 ou après la deuxième Guerre mondiale ; ce vaste ensemble comprend des mouvements d’inspiration shintoïste, ainsi que des sectes se réclamant du bouddhisme tantrique ou d’écoles diverses du bouddhisme japonais (comme la puissante Soka Gakkai apparue en 1930) et de syncrétismes de toutes natures[2]. Certaines peuvent se livrer à des dérives sectaires, voire criminelles[3].
[1] Le nombre réel des Aïnous du Japon est inconnu, car beaucoup d’entre eux taisent leurs origines, afin d’échapper aux discriminations. Ceux de Sibérie russe se réduisent à quelques centaines de personnes.
[2] Ces différentes associations religieuses sont au nombre de 180 000 dans l’archipel.
[3] En mars 1995, treize passagers du métro de Tokyo sont tués par du gaz sarin, diffusé par des adeptes d’Aum Shinrikyo, une secte bouddhiste matinée d’emprunts à l’hindouisme, à l’ésotérisme New Age et à l’apocalyptisme chrétien.
SOMMAIRE
- Des premiers peuplements aux premiers royaumes
- Apogée et déclin des Fujiwara
- Trois siècles de tourmente
- L’archipel se referme
- L’ère Meiji, l’heure de la modernisation
- Les débuts de l’expansion territoriale
- Mise sous tutelle et retour à l’indépendance
- Prospérité et fragilités
- ENCADRE : Les Aïnous, plus vieux peuple du Japon
- ENCADRE : L’imbroglio d’Okinawa
- ENCADRE : L’autodéfense en question
- ENCADRE : Des litiges maritimes avec tous les grands voisins
- ENCADRE : Les plaies mal refermées de l’occupation « coloniale »

Des premiers peuplements aux premiers royaumes
Le Japon est probablement habité, par des populations clairsemées, depuis 150 000 ans. Entre 20 000 et 12 000 ans avant l’ère commune, arrivent des chasseurs-cueilleurs, sans doute originaires du Tibet et du sud-ouest de la Chine : ayant d’abord migré vers la Mongolie et la Sibérie, ils auraient ensuite profité des ponts terrestres créés par la glaciation de Würm entre la Corée et l’archipel japonais pour gagner ce dernier. Des vagues successives de migrations, issues de Mongolie ou du Sud-Est de la Chine vont suivre au cours des millénaires suivants, depuis le nord par Hokkaidō, l’ouest par le détroit de Corée ou le sud depuis Taïwan, via l’archipel des Ryūkyū[1]. Ces migrants donnent naissance à la culture Jomon ; tenant son nom du motif décoratif principal (un dessin cordé) qui orne ses poteries, elle compte parmi les plus anciennes du monde (vers -13 000).
La culture Jomon est progressivement évincée par la culture de Yayoi (du nom d’un site archéologique proche de Tokyo), que propagent de nouveaux arrivants débarqués de Corée vers -1 000, dans le sud de Kyūshū. Caractérisée par la riziculture inondée, une technique née en Chine, et par la métallurgie du fer et du bronze, elle assimile les populations préexistantes et se mêle à elles pour donner naissance au peuple japonais. La culture Jomon se prolonge durant quelques siècles encore, dans l’île d’Ezo (Hokkaido) où ont été repoussés les ancêtres des Aïnous[2]. Ceux-ci, comme tous les peuples « Jomon », vénèrent les kami, les esprits qui habitent des lieux particuliers tels que les forêts ou qui incarnent des forces naturelles comme le vent, les rivières et les montagnes. Ce culte koshintō va s’épanouir durant la période Yayoi, avec la réalisation d’objets de vénération des esprits, et devenir la religion nationale : le shintoïsme (« la voie des dieux »).
C’est à la même époque, à la fin de la culture Jomon, que serait né le premier royaume du Japon : il aurait été fondé, vers -660, par l’Empereur mythique Jimmu, descendant d’Amaterasu, la déesse du soleil. Selon la tradition, tous les empereurs japonais sont issus de la lignée de ce premier souverain[3]. En réalité, l’archipel – connu au 1er siècle EC en Chine sous le nom de pays de Wa (pays des nains) – n’est pas encore unifié, mais constitué d’une myriade de principautés, dont certaines entretiennent des liens avec la Corée et la Chine. Au IIIe siècle, un certain nombre de ces petits royaumes, situés au centre de Honshu et au nord de Kyushu, s’unissent dans un pays de Yamatai, dont l’impératrice paie tribut à la Chine, tout en intervenant en Corée : elle y impose sa tutelle à la ligue de Kaya (baptisée Minama en nippon[4]) et envoie des combattants soutenir ses alliés engagés dans les guerres inter-coréennes.
Mais la véritable unification du Japon débute, vers 250, dans la plaine fertile de Yamato, au centre de Honshu. A la culture de Yayoi a alors succédé la période de Kofun, issue d’une nouvelle vague migratoire venue de Corée : elle se caractérise par de grands complexes funéraires et par des contacts étroits avec les États coréens de Kaya et de Paekche. C’est par leur intermédiaire que pénètrent au Japon des pratiques telles que le tissage et la sériciculture, l’écriture chinoise et le bouddhisme, à partir de 538. Mâtinée d’influences chinoises, la nouvelle religion entre en concurrence avec le shintoïsme et s’impose comme culte officiel du royaume de Yamato, durant cette période dite d’Asuka : en 586, après une épidémie de peste, l’Empereur Yomeï fait en effet vœu de soumission au Bouddha, sous l’influence des Soga, un clan d’origine coréenne (comme une partie de l’aristocratie japonaise) qui l’a emporté sur les familles pro-shintoïstes telles que les Nakatomi. En 604, le prince Shotoku promulgue une « Constitution » de dix-sept articles, d’influence confucianiste, qui autorise à la fois le shintoïsme et les sectes bouddhistes.
[1] Le gène des « Jomon » présente des similitudes avec celui des aborigènes taïwanais.
[2] Les Aïnous, comme une grande partie des Ryukyuans au sud, apparaissent comme les descendants directs des « Jomon », s’étant faiblement mélangés avec les nouveaux arrivants.
[3] Cette tradition est vérifiée sur les quinze derniers siècles, ce qui fait de la monarchie japonaise un cas unique au monde.
[4] Le Japon perd ces territoires dans la seconde moitié du VIe, au profit du royaume coréen de Silla.
Apogée et déclin des Fujiwara
En 645, les Nakatomi renversent les Soga. Sous le nouveau nom de Fujiwara, ils adoptent des institutions inspirées de la Chine des Tang : la réforme de Taika vise à créer un gouvernement centralisé sur le modèle chinois, via la révision du système des taxes, la refonte de l’administration, la création d’un réseau routier et postal et la redistribution des terres. Le royaume de Yamato se dote de tous les attributs d’un État centralisé, bien qu’il n’exerce sa pleine autorité que sur le centre-ouest de l’archipel, le reste étant délégué à des grands féodaux (les daimyo). A la fin du VIIe siècle, l’Empereur Temmu commence à faire rédiger deux textes, le Kojiki (recueil des choses anciennes) et le Nihongi (chronique du Japon), qui consacrent l’origine divine de la famille impériale, descendante de la déesse du Soleil. C’est à cette époque que le Yamato devient connu sous le nom de Nippon (« origine du soleil ») et que l’Empereur prend le nom de Tenno (Empereur céleste). En 701, le Code de Taiho pose par écrit les règles d’organisation féodale du pays, favorisant l’attribution de terres aux nobles et aux temples bouddhistes, au détriment des populations paysannes. Neuf ans plus tard, une capitale permanente est instaurée à Heijo, plus connue sous le nom de Naira, dans la plaine de Yamato.
La Cour y reste cependant moins d’un siècle : en 794, l’Empereur Kammu fait construire une nouvelle capitale, non loin de là, à Heian (future Kyoto). Le faste qui règne au palais, notamment sur le plan artistique, contribue à isoler l’Empereur de la vie réelle du pays et, in fine, à l’affaiblir. Dans la première moitié du IXème, l’armée impériale doit également affronter des révoltes des Aïnous du Tohoku, la dernière région de Honshū à avoir été peuplée par les Japonais entre les VIIème et IXème siècles. Dès le milieu du IXème, les Fujiwara réinstaurent la primauté de l’identité culturelle nippone, en même temps que l’influence du bouddhisme décline, y compris en Chine[1]. La réalité du pouvoir à la Cour étant exercée par les régents Fujiwara, l’Empereur se trouve réduit à un rôle essentiellement spirituel, celui de grand prêtre shinto. En province, les daimyos s’émancipent et entretiennent de puissantes armées privées, constituées de samouraïs (« ceux qui servent) et de bushi (guerriers). Durant deux siècles, deux de ces clans provinciaux vont se livrer bataille : les Taira, basés près de la Mer intérieure à l’ouest, et les Minamoto, implantés dans la région du Kanto, au centre-est de Kyushu. Les seconds jouent régulièrement le rôle de supplétifs des Fujiwara, qui sont alors à leur apogée[2].
En 1156, les rivalités claniques tournent à l’affrontement direct, lorsque deux chefs des Fujiwara se disputent le contrôle de la Cour impériale et font appel, l’un aux Minamoto, l’autre aux Taira. Ces derniers s’étant imposés, ils s’emparent de la réalité du pouvoir, au détriment des Fujiwara, avant d’être vaincus par leurs rivaux, à l’issue de la guerre de Genpei (1180-1185). Dans la foulée, les Minamoto éliminent les derniers Fujiwara, qui s’étaient réfugiés au nord, et leur chef Yoritomo se fait attribuer, à vie, le titre de shogun[3], en échange de sa loyauté à l’Empereur. Détenant l’effectivité du pouvoir, il installe sa propre administration (le bakufu, « gouvernement sous la tente ») dans son fief du Kanto, à Kamakura (au sud de l’actuelle Tokyo).
[1] Le déclin du bouddhisme traditionnel favorisera, à la fin du XIIème, l’introduction du bouddhisme zen de Chine.
[2] Le seul à contester la suprématie des Fujiwara est Go-Sanjô (1068-1072), le premier Empereur à ne pas avoir de mère Fujiwara depuis 170 ans.
[3] « Généralissime soumettant les barbares ».

Trois siècles de tourmente
Après la période de troubles qui suit la mort de Yoritomo, sa veuve parvient à imposer comme régents (shikken) des membres de sa famille, les Hojo, descendants des Taira. Leur régence étant devenue héréditaire, ils dominent de fait le shogunat Kamakura, donc le pays, à partir des années 1220, tout en redonnant un peu de lustre à la Cour impériale de Kyoto. En 1274, après avoir refusé de payer tribut à la Chine, passée sous domination des Mongols, le Japon voit déferler sur ses côtes des centaines de bateaux sino-mongols. Mais ils sont victimes d’une tempête si violente qu’ils doivent se replier sur la Corée. Leur deuxième tentative de débarquement, en 1281, n’est pas davantage couronnée de succès : la moitié de leur flotte est détruite par un typhon auquel les Japonais vont donner le nom de « kamikaze » (vent divin).
Si l’archipel a réussi à conserver son indépendance, le renforcement de ses défenses a coûté cher au shogunat Kamakura, dont la puissance se retrouve amoindrie. Ayant accédé au trône en 1318, l’Empereur Go-Daigo décide d’en profiter pour restaurer l’autorité impériale. Après plusieurs revers, il obtient le ralliement du général Takauji, un membre de la famille Ashikaga (descendant des Minamoto) qui avait été envoyé le combattre, tandis qu’un autre Minamoto, le général Yoshisada, se révolte contre le shogunat et détruit Kamakura en 1333. Le pouvoir impérial n’est pas rétabli pour autant : Takauji s’étant vu refuser le titre de shogun, il se révolte contre l’Empereur, bat son rival Yoshisada et s’empare de Kyoto en 1338, y installant un souverain à sa solde. Deux pouvoirs se font désormais face : le bakufu Ashikaga, installé à Muromachi près de Kyoto, et la Cour de Go-Daigo, réfugiée plus au sud, à Yoshino.
En 1392, les deux Cours sont réunifiées par le shogun Ashikaga et les relations avec la Chine apaisées, via la signature (en 1443) d’un traité avec les Ming, qui ont succédé aux Mongols. Mais la situation intérieure est de plus en plus volatile. En province, les grands féodaux se sont renforcés au fur et à mesure que l’autorité centrale s’affaiblissait et se livrent des guerres sans merci, tandis qu’au nord éclatent des révoltes paysannes inspirées par une secte bouddhiste. La guerre d’Onin (1467-1477) s’étant terminée sans vainqueur, une période d’instabilité s’installe pour près d’un siècle. C’est durant cette période Sengoku des « royaumes combattants » que les premiers Européens arrivent au Japon. En tête de liste figurent des Portugais naufragés (en 1543), suivis bientôt par d’autres ressortissants tels que le jésuite espagnol François-Xavier.
La réunification du Japon débute au milieu du XVIe siècle, sous l’égide de Nobunaga, un daymio du centre de Honshu, qui s’empare de Kyoto en 1568. Son entreprise est achevée, vers 1590, par un de ses généraux, Hideyoshi : il redistribue les terres conquises à des vassaux loyaux, désarme les paysans, achève la conquête d’Hokkaido et s’attaque aux missions chrétiennes, jugées trop envahissantes (alors que son prédécesseur avait persécuté les bouddhistes, considérés comme trop favorables aux révoltes paysannes) : une vingtaine de chrétiens sont crucifiés en 1597. Le nouvel homme fort du pays se montre également belliqueux vis-à-vis de la Corée, qu’il essaie d’envahir par deux fois, en 1592 puis 1597 : à chaque fois c’est un échec, les Coréens ayant bénéficié de l’aide de leur suzerain chinois.
L’archipel se referme
La mort d’Hideyoshi est suivie d’une guerre de succession qui débouche en 1600 sur la victoire d’un des plus grands féodaux du pays, Tokugawa Ieyasu, implanté à Edo (future Tokyo), dans la plaine du Kanto. Ayant fait restaurer le titre de shogun, inemployé depuis une vingtaine d’années, il assure la mainmise de son clan Tokugawa sur le Japon. La volonté de stabiliser le pays passe par l’édiction de réglementations sociales très strictes, en particulier par le découpage de la société en quatre classes (hors clergé et nobles de la Cour) : au sommet de la pyramide figurent les samouraïs[1], suivis des paysans, des artisans et des marchands. Tout en bas de l’échelle figurent les « hinin » (colporteurs, acteurs[2]…) et les « eta » (ou impurs, correspondant aux actuels « burakumin »). La réalité du pouvoir est exercée par les shoguns qui possèdent une grande partie des richesses du pays et maintiennent les daimyo dans un état de forte dépendance, les obligeant notamment à résider une année sur deux à Edo. Beaucoup de clans se voient même attribuer arbitrairement de nouveaux fiefs (han), mais pas tous : en échange d’une allégeance, parfois forcée, les plus puissants conservent leurs territoires, à l’image des Shimazu qui gouvernent depuis quatre siècles la province de Satsuma, au sud de Kyūshū et contrôlent quasiment toute l’île à la fin du XVIe. Redoutant de perdre leur obéissance, les Tokugawa les laissent envahir, en 1609, un archipel situé au sud de leurs côtes, autour de l’île d’Okinawa : le royaume de Ryūkyū, unifié depuis 1429 et tributaire de la Chine. En pratique, les Shimazu ne s’emparent que des îles les plus au nord, laissant le reste du royaume dépendre des Chinois, en échange de facilités commerciales.
Pour le pouvoir d’Edo, la conquête – même partielle – des Ryūkyū est aussi un moyen de créer une zone tampon entre le Japon et les intérêts occidentaux dans la région, à Taïwan ou aux Philippines. Les Européens, qui avaient commencé à ouvrir des comptoirs au Japon dans les années 1610, y sont en effet devenus persona non grata. Seuls les Hollandais sont autorisés à conserver une enclave au large de Nagasaki. Le christianisme, qui avait réussi à poursuivre son implantation après les persécutions de la fin du XVIe, est considéré comme une menace politique : les missionnaires sont expulsés et 37 000 personnes, majoritairement chrétiennes, massacrées en 1638 à l’issue de la révolte de Shimabara, dans la région de Nagasaki. Contraints de se faire enregistrer dans un temple bouddhiste pour démontrer qu’ils ne sont pas chrétiens, les Japonais ont également interdiction de quitter le territoire à partir des années 1630.
Malgré cette fermeture – à laquelle n’échappe que le commerce avec les Coréens et les Chinois – l’économie du pays se développe, en dépit de famines, d’inondations, de séismes et d’éruptions volcaniques (comme celle du mont Fuji en 1707). La paix, accompagnée d’une amélioration des rendements agricoles, permet aux paysans d’accroître légèrement leur niveau de vie. Elle favorise aussi la diffusion de l’enseignement, ainsi que l’essor des activités manufacturières et du commerce, au risque que l’enrichissement des marchands ne fasse ombrage au pouvoir des samouraïs et de la noblesse. Sur le plan territorial, le Japon soumet les derniers Aïnous indépendants d’Hokkaido, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles[3]. Les autorités nippones sont d’autant plus sûres de la justesse de leur choix de fermeture que, à la même période, le puissant voisin chinois est soumis à la signature de « traités inégaux » par les Occidentaux et les Russes.
[1] C’est à cette époque que naît le code d’honneur des samouraïs : le bushido (« voie des guerriers »).
[2] Le théâtre Nô est né dans le dernier quart du XIVème et le Kabuki au début du XVIIème.
[3] Bataille de Kunashiri-Menashi en 1789.

L’ère Meiji, l’heure de la modernisation
Le « splendide isolement » s’achève sous la pression américaine. Après avoir laissé un an de préavis à l’Empereur, les États-Unis déploient des navires de guerre dans la baie d’Edo en 1854. Par le traité de Kanagawa, le Japon ouvre deux ports et une représentation consulaire aux Américains, brèche dans laquelle s’engouffrent les autres puissances dès les mois suivants. Ces épisodes provoquent la chute du shogunat, rendu responsable de cette série de soumissions. En 1869, ses dernières troupes sont battues par l’alliance conclue entre trois grands clans provinciaux, désireux de restaurer l’autorité impériale : les Shimazu, les Choshu (de l’extrême-ouest de Honshu) et les Tosa (du sud de Shikoku).
Dès 1868, l’Empereur Mutsuhito édicte une charte qui s’engage à des réformes, y compris en s’appuyant sur les savoirs étrangers. Installé à Edo, qui prend le nom de Tokyo (« capitale de l’Est »), l’État reprend la main sur les grands domaines du shogun et des daimyo. Le nombre de classes est réduit aux nobles (les kazoku), aux roturiers (les heimin) et aux samouraïs (shizoku), dont la disparition est programmée : leur dernière révolte est matée en 1877. Comme promis, cette ère Meiji (« époque éclairée ») s’accompagne de réformes dans tous les domaines, notamment via le concours de techniciens étrangers. Le coût de cette aide est en partie supporté par des intérêts privés, dénommés zaibatsu (« clique financières »).
S’il est ouvert sur le plan économique, le pouvoir ne l’est pas d’un point de vue politique et diplomatique. Jouant la carte nationaliste, il profite d’incidents navals répétés avec la Corée, alors repliée sur elle-même, pour la forcer à ouvrir trois de ses ports au commerce nippon, en 1876. Il a aussi engagé avec le royaume de Ryūkyū une guerre de sept ans qui le conduit à l’annexer totalement en 1879 : incorporé au Japon, l’archipel devient département d’Okinawa. Sur le plan institutionnel, une Diète de deux Chambres est instituée par la Constitution : une Chambre des pairs (largement constituée de daymio) et une Chambre des représentants (élue au suffrage censitaire, uniquement par des hommes). Les premières élections, qui se déroulent en 1890, voient le succès d’un certain nombre de formations critiques du pouvoir. En pratique toutefois, les gouvernements sont souvent dirigés par des libéraux qui n’ont de responsabilité que devant l’Empereur. Le pouvoir de celui-ci est pour sa part encadré, ce qui ne l’empêche pas de faire l’objet d’une véritable vénération. Le « shinto impérial » a d’ailleurs quasiment le statut de religion d’État.
Les débuts de l’expansion territoriale
En 1882, six ans après que Tokyo y a obtenu des privilèges commerciaux, des émeutes anti-japonaises éclatent en Corée. Des troupes nippones sont alors déployées dans la péninsule coréenne, de même que des troupes chinoises, au nom de la protection que la Chine a garantie au régime de Séoul. Les deux pays ne les retirent qu’en 1885, après la signature d’un accord, avant de les faire revenir quelques années plus tard : le roi coréen ayant appelé son suzerain chinois à l’aide pour mater une révolte, en 1894, le régime japonais envoie également des soldats. Mais, une fois la rébellion matée, aucun des deux pays ne veut retirer ses troupes. Le Japon profite de ce blocage pour déclarer la guerre à la Chine, dont il détruit la flotte en février 1895. La défaite de l’Empire des Qing se traduit par la signature du traité de Shimonoseki qui attribue à Tokyo les péninsules chinoises de Liaodong et du Guandong (avec Port-Arthur) au sud de la Mandchourie, ainsi que Taïwan et les îles Pescadores. De son côté, la Corée quitte l’orbite chinoise pour devenir indépendante mais entre, en réalité, dans la mouvance japonaise.
Les Coréens essaient d’y échapper en sollicitant l’aide de la Russie, dont la puissance inquiète Tokyo : déjà très active en Mandchourie, elle a en effet récupéré le Liaodong et le Guandong… après avoir d’abord contraint les Nippons à les restituer à la Chine. Ayant fortement investi dans son armement, le Japon déclare la guerre aux Russes en 1904 et détruit leur flotte l’année suivante dans le détroit de Tsushima, entre la Corée et le Japon. Auparavant, les troupes nippones ont débarqué en Mandchourie, repris Port-Arthur et Moukden et réoccupé le Liaodong. Le traité signé en septembre 1905 à Portsmouth, sous l’égide des États-Unis, redonne à l’Empire du soleil levant les péninsules de Liaodong et Guandong, ainsi que le contrôle du chemin de fer sud-mandchourien ; la Russie est également contrainte de céder au Japon le sud de la grande île de Sakhaline (Karafuto en japonais). Le texte reconnaît aussi la suprématie japonaise en Corée, qui est définitivement annexée en 1910. Les Coréens étant considérés comme « une race inférieure », leur pays est soumis à une exploitation de type colonial, encadré par un régime répressif. Le pouvoir est tout aussi autoritaire au Japon même, en particulier à l’égard des opposants de gauche.
En 1914, Tokyo entre dans la première Guerre mondiale, contre l’Allemagne, et s’empare des territoires que le Reich avait achetés aux Espagnols dans le Pacifique (îles Mariannes, Carolines et Marshall), ainsi que de ses possessions dans le Shandong chinois. En 1918, les troupes japonaises occupent le nord de la Mandchourie et l’est de la Sibérie, dont elles viennent de chasser les bolchéviques russes. A l’issue du conflit, le Japon obtient un mandat de la Société des nations (SDN) sur les archipels du Pacifique mais, sous la pression des États-Unis, doit rendre le Shandong à la Chine et se retirer du nord mandchou. Le ressentiment des Japonais contre les Occidentaux s’accroit d’autant plus que le pays est confronté à des difficultés économiques croissantes et que les Américains, comme les Australiens, s’opposent à toute immigration nippone sur leur sol.
En 1923, un tremblement de terre fait plus de 100 000 morts dans la région de Tokyo et débouche, par ricochet, sur une chasse aux migrants coréens, accusés d’avoir empoisonné des puits et déclenché des incendies. Les violences font entre 2 600 et 6 600 victimes coréennes, mais aussi plusieurs centaines parmi les Chinois, les burakumin et des militants politiques. A partir de 1927, la crise affecte les paysans et les petites entreprises, alors que les « zaibatsu », tels que Mitsubishi, demeurent choyés par le pouvoir. Une partie de la population commence à dénoncer la collusion entre milieux d’affaires et politiciens et à contester le régime : celui-ci s’est libéralisé au milieu des années 1920, avec l’instauration du suffrage universel masculin. La gouvernance libérale est également remise en cause par les conservateurs, en particulier par certains militaires : c’est le cas des officiers de l’armée déployée dans la péninsule chinoise du Guandong qui multiplient les incidents en Mandchourie, tout en les imputant à des « bandits chinois ». En septembre 1931, Tokyo occupe la Mandchourie en prenant pour prétexte d’un attentat sur le chemin de fer sud-mandchourien – « l’incident de Moukden » – qui, en réalité, a été perpétré par ses propres services. Cinq mois plus tard, le Japon y proclame l’indépendance, purement factice, du Mandchoukouo[1]. Le premier ministre japonais, qui essayait de reprendre le contrôle de la situation, est assassiné et le pouvoir passe de fait aux mains des militaires, avec l’approbation de l’Empereur Hirohito, arrivé sur le trône en 1926. Leur emprise croissante se traduit notamment par la publication, en 1937, d’un mémento sur « les fondements de la nation », prônant un dévouement total à l’Empereur et la suprématie de la société sur l’individu.
[1] En 1933, les Nippons adjoignent au nouvel « Empire mandchou » la province chinoise de Johol – au nord de Pékin – qu’ils viennent de conquérir, puis confient le trône à Puyi, le dernier souverain des Qing. En 1935, ils récupèrent le chemin de fer de l’est chinois, en échange d’une indemnité versée à la Russie.
Le militarisme japonais à l’épreuve de la deuxième Guerre mondiale
A l’été 1937, un incident entre soldats chinois et japonais sur un pont de Pékin déclenche une guerre ouverte entre le Japon et la Chine. En deux ans, les troupes nippones s’emparent de Pékin, de Shanghai, de Nankin (dont le « sac » fait 100 000 morts en décembre 1937) et de la région de Canton. Directement, ou par le biais d’un gouvernement « de collaboration » établi à Nankin, le Japon contrôle les plaines du nord de la Chine et toutes les zones utiles, industrielles ou portuaires, avec l’objectif d’asphyxier économiquement le pouvoir nationaliste, réfugié au sud-ouest. En septembre 1940, l’armée impériale ouvre un nouveau front : profitant de la défaite de la France face aux Allemands, elle commence à se déployer dans les colonies françaises d’Indochine. Au même moment, Tokyo signe un pacte tripartite avec l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie, bien que Hitler ait classé des Japonais parmi les « races inférieures ».
Lorsque le IIIème Reich attaque l’URSS en juin 1941, le Japon entre de plain-pied dans la deuxième Guerre mondiale. Les Soviétiques ayant dû alléger leur dispositif militaire en Mandchourie, Tokyo peut y diminuer ses propres forces et conquérir l’ensemble de l’Indochine française. Les Américains entrent alors en jeu et instaurent un embargo sur les exportations vers le Japon, notamment de pétrole. Une tentative de négociation ayant échoué, la flotte japonaise bombarde la base américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, en décembre 1941, sans déclaration de guerre préalable[1]. Le même jour, les forces nippones commencent, en Malaisie, un déploiement qui va les conduire en quelques semaines à occuper une large partie du sud-est asiatique (de Hong-Kong à Rangoon et Batavia, en passant par Singapour et Manille). A son apogée, l’empire du Japon occupe huit millions de km².
Mais la tendance s’inverse à partir de juin 1942, lorsque la flotte américaine remporte la bataille navale de Midway, au large d’Hawaï. En février 1943, les Japonais sont expulsés de l’île de Guadalcanal (dans les îles Salomon), après six mois de violents combats. Leur situation se dégrade aussi dans leurs possessions d’Asie du Sud-Est : d’abord considérée comme libératrice par certains leaders locaux – vis-à-vis des colonisateurs européens – leur présence, parfois brutale, leur aliène progressivement le soutien des populations. Conscients que leur expansion territoriale prend fin, les dirigeants nippons s’arc-boutent sur la défense de leur archipel, quitte à mener une guerre extrêmement meurtrière, afin de conduire les Alliés à négocier pour mettre fin aux tueries : c’est dans cet esprit que sont imaginés les « avions suicide » (kamikaze), utilisés pour la première fois en octobre 1944, dans ce qui devient la plus grande bataille navale de l’histoire, celle de Leyte aux Philippines. La destruction de flotte japonaise accélère la progression des forces américaines : en avril 1945, elles s’emparent d’Okinawa, après des combats acharnés et des suicides de masse parfois imposés aux civils par les militaires nippons (140 000 morts, soit 20 % de la population).
L’Allemagne ayant capitulé le mois suivant, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine appellent le Japon à en faire de même, sans condition, sous peine de subir des destructions massives. Mais Tokyo refuse. Le 6 août, les Américains larguent sur Hiroshima la bombe atomique qu’ils ont mise au point quelques semaines plus tôt . Le Japon n’ayant pas réagi, une seconde bombe est lancée sur Nagasaki trois jours plus tard. La veille, l’URSS a déclaré la guerre au Japon et a attaqué la Mandchourie. Les Japonais capitulent finalement le 2 septembre 1945. Entre 1931 et cette date, près de trois millions de leurs soldats sont morts au combat et le nombre de victimes civiles dépasse un demi-million de morts[2].
[1] Aucune déclaration n’avait davantage précédé les guerres contre la Russie (1905) et la Chine (1937).
[2] Les deux bombes atomiques font 250 000 morts, dont 140 000 sur le coup.

Mise sous tutelle et retour à l’indépendance
En juillet 1945, la déclaration de Potsdam a décidé de ramener le Japon à ses frontières de 1868 : la Corée retrouve son indépendance, tandis que la Mandchourie et Taïwan reviennent à la Chine, le sud de Sakhaline à l’URSS et que les archipels japonais du Pacifique sont confiés aux États-Unis dans le cadre d’un mandat de l’ONU. Le traité de San Francisco, en 1951, confirme cette redistribution et confie à Washington l’administration d’Okinawa et des îles Bonin avoisinantes[1]. Sous la direction du général Mac Arthur, les Américains héritent aussi de la gestion du Japon, placée sous contrôle international. Leur première mission est de démilitariser le pays et de purger le régime de ses éléments les plus radicaux. Un tribunal militaire international condamne à mort sept hauts dirigeants, jugés en tant que criminels de guerre ; d’autres échappent à la peine capitale car considérés comme indispensables au redémarrage du pays[2]. Hirohito échappe aussi à la purge, les États-Unis préférant ne pas fragiliser l’institution impériale, considérée comme un gage de stabilité. En revanche, le souverain perd son statut de « dieu incarné » et détient désormais son pouvoir du peuple ; quant au shintoïsme, il retrouve un statut similaire à celui des autres cultes.
Le régime d’occupation entreprend des réformes tous azimuts. Sur le plan économique, une réforme agraire fait de 90 % des paysans les propriétaires de leurs terres, tandis que le droit de grève est reconnu. D’un point de vue culturel, l’enseignement est expurgé de ses couplets ultra-nationalistes. Quant aux institutions, elles sont profondément changées : les partis (comme les syndicats) sont de nouveau autorisés et un régime parlementaire introduit par une nouvelle Constitution, promulguée fin 1946. La situation du pays, notamment sociale, n’est pas stabilisée pour autant. Washington en tient compte et, à partir de 1948, réoriente sa politique en faveur de la relance économique, renonçant par exemple à démembrer les zaibatsu jugés trop puissants.
La reprise est favorisée par la guerre de Corée qui, à partir de 1950, réclame de forts approvisionnements pour les troupes de l’ONU engagées dans la péninsule voisine. Les soldats américains du Japon faisant partie de ce contingent international, Mac Arthur va mettre sur pied des « Forces d’autodéfense » japonaises, « arrangement » avec l’article 9 de la Constitution qui interdit tout recours à la guerre « comme moyen de régler des différends internationaux », même au sein d’un système de défense collective. Entretemps, l’archipel a retrouvé sa peine indépendance, en septembre 1951, après avoir signé un traité de paix avec une quarantaine de pays[3], au rang desquels ne figure pas l’URSS. Dans un contexte de guerre froide, Tokyo signe un traité de sécurité avec Washington la même année.
[1] Les îles Bonin sont rendues au Japon en 1967 et Okinawa en 1972.
[2] A l’image de Nobusuke Kishi, vice-ministre des Munitions du général Tōjō pendant la guerre, qui deviendra Premier ministre en 1957.
[3] Un traité séparé est signé avec Taïwan en 1952.
Prospérité et fragilités
Les décennies qui suivent sont marquées par un boom économique sans précédent[1], soutenu par l’aide américaine et par un ministère de l’industrie omnipotent, le MITI, qui oriente l’immense majorité des investissements vers la construction navale, les aciéries, l’industrie chimique et l’industrie automobile. Ce « miracle économique » est favorisé par une grande stabilité politique : le Parti libéral-démocrate (PLD), fondé par fusion des deux partis libéraux en 1955, gouverne sans interruption jusqu’en 1993 en s’appuyant, si nécessaire, sur les gangs criminels des yakuzas. Rien n’entame cette domination, malgré l’agitation des étudiants de gauche contre les inégalités sociales ou contre la trop grande dépendance vis-à-vis des États-Unis. L’admission à l’ONU en 1956 – favorisée par la mort de Staline – puis l’organisation des Jeux Olympiques, en 1964, consacrent le retour au premier plan du Japon sur la scène internationale. Il devient même le premier partenaire commercial de la Chine populaire, malgré l’absence de relations diplomatiques avec Pékin.
Fortement contesté en 1960, le renouvellement automatique du traité de sécurité nippo-américain se fait cette fois sans opposition massive, en dépit de la guerre en cours au Vietnam ; les mouvements de citoyens se mobilisent davantage en faveur de l’environnement, notamment après la révélation de la pollution au mercure des eaux poissonneuses de Minamata (Kyushu), depuis la fin des années 1950. Comme l’Allemagne et l’Italie, le Japon est secoué par la contestation étudiante de 1968 et ses dérives terroristes : l’Armée rouge s’illustre par quelques actions sur le territoire japonais, mais surtout à l’étranger où elle participe, aux côtés du FPLP palestinien, à l’attentat meurtrier de l’aéroport israélien de Lod, en 1972. Les violents heurts entre factions conduisent à la disparition du mouvement, dont les derniers membres en liberté se réfugient en Corée du Nord ou au Proche-Orient.
Globalement, la population nippone reste à l’écart des extrémismes de tous bords et poursuit le développement économique du pays, en particulier vers les pays du sud-est asiatique. Ce dynamisme est tel que, dès le début des années 1970, les États-Unis commencent à mettre des barrières aux importations japonaises, en même temps qu’ils renouent avec la Chine populaire en 1972 (ce qui conduit Tokyo à le faire aussi la même année). A partir de 1982, le Premier ministre Nakasone accélère la croissance de l’économie japonaise – devenue la deuxième du monde – en limitant les pouvoirs des syndicats et en privatisant de larges pans du secteur public, quitte à générer de retentissants scandales politico-financiers. Il remet également au premier plan la puissance passée de l’Empire en se rendant au sanctuaire shintoïste Yasukuni, qui honore les soldats morts pour la patrie, y compris ceux ayant participé à l’expansion nippone des années 1930-1940 (cf. Les plaies mal refermées de l’occupation « coloniale »).
Mais au début des années 1990, au lendemain de l’avènement sur le trône de Akihito (son père étant mort en 1989), la croissance marque le pas, en même temps qu’éclate la bulle spéculative, financière et immobilière, qui avait favorisé le boom des années 1980. Le mécontentement ayant grandi dans la population, le PLD n’obtient pas la majorité parlementaire aux élections de 1993 et doit abandonner le pouvoir qu’il détenait depuis plus de trente-cinq ans. Des gouvernements de coalition lui succèdent (dont un est dirigé par un socialiste), mais avec des durées de vie parfois si éphémères que le PLD remporte les législatives anticipées de 1996, boudées par plus de 40 % des électeurs : arrivé en tête, il n’obtient toutefois pas la majorité absolue et doit compter avec des soutiens ponctuels et avec l’émergence d’une nouvelle formation de centre-gauche, le Parti démocrate. Il n’en renoue pas moins avec ses vieilles pratiques, distribuant les grands portefeuilles ministériels entre ses quatre grands clans et frayant avec le monde des affaires ; début 1998, le ministre des Finances doit démissionner après la preuve d’une collusion entre deux fonctionnaires de son ministère chargés de la surveillance des banques et les milieux économiques. La sanction tombe aux législatives d’août 2009 : le PLD est laminé par le Parti démocrate, dont le crédit est néanmoins rapidement mis à mal par sa reculade au sujet de la base américaine de Futenma (cf. L’imbroglio d’Okinawa) en 2010, puis par la gestion de l’accident nucléaire de Fukushima en mars 2011[2].
Fin 2012, les Japonais redonnent donc une large majorité au PLD qui, avec son allié du Nouveau Komeito[3], détient la majorité dans les deux Chambres de la Diète. Le Parti pour la restauration du Japon, fondé en septembre 2012 par les très populistes et nationalistes maire d’Osaka et ancien gouverneur de Tokyo, devient la troisième force de la Chambre basse : cette percée confirme que les Japonais qui ont voté (moins de 60 %, la plus faible participation jamais enregistrée) l’ont fait sur des critères largement nationalistes, en pleine période de tensions avec la Chine. Ce positionnement est aussi celui du chef du PLD : petit-fils de Nobusuke Kishi, le Premier ministre Shinzo Abe (déjà titulaire du poste en 2006-2007) est partisan de l’abolition de l’article 9 et de la transformation des Forces d’autodéfense en véritable armée (cf. L’autodéfense en question). Il est aussi un fervent supporter de la restauration du shintoïsme dans la vie politique et identitaire nationale (et avec lui de la figure impériale et de la puissance du « Japon éternel »), en dépit de la séparation constitutionnelle de la religion et de l’État. Ainsi, en mai 2016, le sommet international du G7 se tient dans un sanctuaire shinto.
Le chef du gouvernement est également partisan d’une politique de forte relance monétaire et budgétaire de l’économie, alors que la population décroît depuis 2011 et vieillit : 28 % des Japonais ont plus de 65 ans, soit encore plus que dans la « vieille Europe » (en 2022, la population chute de près de 800 000 habitants). Mais les « Abenomics » ne donnent pas les résultats escomptés : le PIB chute en 2020, pour la première fois depuis 2009. En août 2020, Abe démissionne, officiellement pour raison de santé, alors qu’il venait de battre un record de longévité à ce poste. Il est remplacé par son porte-parole, qui se retire à son tour à l’automne 2021.
En août, le pays a connu un événement sans précédent : la première condamnation à mort d’un chef yakuza, accusé d’avoir organisé l’assassinat de citoyens n’ayant aucun lien avec le crime organisé[4]. En octobre, le PLD et son allié du Komeito remportent les législatives, malgré l’alliance passée entre les principales formations d’opposition, des centristes jusqu’aux communistes. Le scrutin, suivi par moins de 56 % des électeurs, montre une droitisation persistante de l’électorat, puisque la principale progression est enregistrée par le Parti de la restauration. Comme toujours, ou presque, le nouveau Premier ministre choisi par les caciques du parti au pouvoir est un pur produit du système, fils et petit-fils de parlementaire.
En juillet 2022, l’assassinat de Shinzo Abe en pleine campagne des élections sénatoriales remet en lumière les liaisons troubles, bien que permises, entre la politique japonaise et les religions : ancien membre de la marine, le tueur affirme avoir voulu venger sa mère, ruinée par « l’Église de l’unification » (ou secte Moon, cf. Corée du sud), dont l’ancien Premier ministre était proche. C’est d’ailleurs son grand-père qui, au nom de la lutte contre le communisme, avait aidé le mouvement à s’implanter dans l’archipel dans les années 1960. Depuis, au fil des décennies, le Japon était devenu le principal pourvoyeur de fonds de la secte, le révérend sud-coréen faisant valoir que les Nippons avaient une dette envers son pays.
En août 2023, un sommet tenu à Camp David (États-Unis) confirme le rapprochement opéré entre Tokyo et Séoul, à l’initiative de la Corée du sud, sur fond de tensions avec la Chine et la Corée du nord. Japonais, sud-Coréens et Américains conviennent de mettre en place un programme d’exercices militaires conjoints sur plusieurs années, d’intensifier leur partage de renseignements et de se consulter en cas de menaces communes. Le partenariat inclut également un volet économique, notamment face aux risques de pénurie de certains produits ou matières premières.
Sur le plan politique, les affaires de corruption n’en finissent pas d’empoisonner la vie du gouvernement : quatre ministres sont limogés en décembre et, le mois suivant, trois des factions du PLD (dont celle du Premier ministre, à laquelle appartenait aussi Abe) annoncent leur dissolution. En septembre 2024, le PLD dote le pays d’un nouveau chef de gouvernement : Shigeru Ishiba, un ancien ministre de la Défense, proche de Taïwan et favorable à la création d’un Pacte de sécurité asiatique, similaire à l’OTAN, destiné à contrer les prétentions de la Chine et de la Corée du nord. Sa convocation de législatives anticipées est un fiasco : pour la première fois depuis 2009, le PLD n’obtient pas la majorité absolue des sièges à la Chambre basse, même avec son allié du Komei. Mais, malgré sa progression, l’opposition demeure divisée entre le Parti démocrate constitutionnel (deuxième parti du pays), le Parti démocrate du peuple (PDP) et plusieurs formations antisystème. Les opposants ne parvenant pas à s’entendre, le Premier ministre reste en fonction à la tête d’un gouvernement minoritaire dépendant du bon vouloir du PDP.
[1] De 1955 à 1973, le PIB augmente de 10 % par an, mais le PIB par habitant demeure moyen.
[2] 22 000 personnes meurent dans le tsunami qui provoque le plus grave accident nucléaire mondial, après celui de Tchernobyl en URSS.
[3] Issu du Komeito, Parti du gouvernement éclairé, né dans les années 1960 en tant que bras politique de la secte bouddhiste Soka Gakkai. Il a repris le nom de Komeito en 2014.
[4] Pudiquement qualifiées de « forces anti-sociales », les bandes criminelles ont un code d’honneur leur interdisant de s’en prendre à des citoyens ordinaires. Elles comptent un peu moins de 26 000 membres contre 184 000 à leur apogée dans les années 1960.

Les Aïnous, plus vieux peuple du Japon
Peut-être arrivés de Sibérie orientale avant même l’ère Jomon – à la même époque, ils sont également présents au sud de la péninsule du Kamtchatka et dans les îles Kouriles et Sakhaline – ou bien plus tard (vers -300), les Aïnous sont mentionnés pour la première fois dans des écrits japonais du VIIIe siècle, sous le terme générique d’Emishi (« barbares »). Eux-mêmes se désignent comme Aïnous (« humains ») ou Utari (« camarades »). Ils vivent alors sur l’île d’Hokkaido et au nord-est de Honshū mais vont être repoussés toujours plus au nord, au fur et à mesure de l’expansion nippone. Au XVe, un clan japonais se développe à Hokkaido, y favorise la pêche et l’agriculture et intensifie le commerce avec l’archipel. Son importance devient telle que les Aïnous, s’estimant lésés, se révoltent en 1669. Mais leur rébellion est écrasée, comme le seront les suivantes.
Au XVIIIe siècle, la conquête du nord de l’île par les Russes pousse les shoguns à s’intéresser plus fortement à la région qu’ils ne l’avaient fait jusqu’alors. Hokkaido est finalement annexée au Japon en 1869 et l’ère Meiji s’accompagne de multiples restrictions pour les indigènes : interdiction de se tatouer le visage et de parler leur langue, obligation d’apprendre la culture japonaise (vêtements, éducation, religion…). Dépossédés de leurs terres (loi de 1899 sur la « protection des anciens indigènes »), parfois réduits à l’esclavage dans les champs et victimes de maux importés tels que l’alcoolisme, les Aïnous finissent par s’intégrer de gré ou de force au mode de vie japonais (de même que ceux de Sibérie sont marginalisés par les colons russes).
Leur reconnaissance a débuté à la fin des années 1960. En 1997, une loi a été votée pour promouvoir leur culture mais sans les reconnaître comme indigènes, statut contraire au mythe de l’unicité du peuple nippon et susceptible d’alimenter des demandes de réparations financières, voire des revendications territoriales (les leurs et celles de l’ancien royaume des Ryūkyū). Leur caractère d’autochtones disposant de leur « propre langue, religion et culture » a finalement été reconnu, à l’unanimité, par le Parlement japonais en 2008. L’année suivante, un nouveau texte a été voté pour promouvoir des mesures visant à instaurer une société respectueuse de la fierté des Aïnous.
Pour en savoir plus : journal du Japon
L’imbroglio d’Okinawa
Restitué au Japon en 1972, le département d’Okinawa reste néanmoins marqué par une forte présence des États-Unis : les trois quarts des 47 000 GI’s présents au Japon se trouvent dans l’île principale (Okinawa), dont 20 % du territoire est occupé par des bases et des terrains américains. Cette présence nourrit un ressentiment d’autant plus grand contre l’occupant qu’il est alimenté par des faits divers sordides (tels que des viols et des accidents de la circulation). Hostile au renouvellement des baux de location de terrains aux Américains, le gouverneur de la région organise, en 1996, un référendum dont les résultats sont sans ambiguïté : 89 % des votants (près de 60 % de participation) se prononcent contre le maintien des bases américaines. Les baux sont finalement renouvelés en échange de l’octroi par Tokyo d’importants crédits à la région la plus pauvre du Japon et du déménagement de la base de Futenma, située en zone urbaine.
Reste à déterminer le lieu du transfert. En 2010, le Premier ministre japonais – pourtant membre du Parti démocrate favorable à la réduction du « fardeau » que les forces américaines font peser sur la population de l’archipel – doit se résoudre à ce que la base demeure dans la région, du fait « des incertitudes en Asie du sud-est », une corvette sud-coréenne venant d’être détruite par les Nord-Coréens à la même période. De leur côté, les Américains annoncent un redéploiement de quelques milliers de leurs soldats vers leurs bases du Pacifique et acceptent que Futenma soit transféré vers une baie du nord-est de l’île ; mais le nouveau gouverneur élu s’y oppose, arguant qu’elle est riche en coraux et en mammifères marins. Du coup, le contentieux demeure entre un département qui ne veut pas être le seul à supporter le poids de la présence américaine au Japon et un pouvoir central qui se satisfait de cette présence à quelques encâblures des îles Senkaku convoitées par la Chine (cf. Encadré sur les litiges maritimes).
L’AUTODEFENSE EN QUESTION En dépit d’une Constitution et d’une opinion largement pacifistes, les « Forces d’auto-défense » japonaises comptent parmi les armées les mieux dotées du monde, notamment en équipements navals et en systèmes de défense anti-missiles. Depuis son adoption, l’article 9 de la Loi fondamentale qui interdit le recours à la guerre, a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs ajustements. En 1999, la Diète a étendu le périmètre de défense non plus au seul territoire japonais, mais à toutes les régions limitrophes. La même année, Japon et États-Unis signent un accord de partage technologique en matière de défense antimissile, afin de face aux menaces Nord-Coréennes. Deux ans plus tard, la mobilisation des Forces d’auto-défense est autorisée pour protéger les bases militaires américaines dans le pays, de même qu’est permis le déploiement de centaines de soldats au sein de la coalition internationale destinée à combattre le terrorisme islamiste en Irak : chargés de missions de surveillance, de logistique, d’aide sanitaire et de renseignement, les militaires nippons sont même autorisés à faire usage de leurs armes pour se défendre ou protéger des blessés. Fin 2004, Tokyo publie un Livre blanc sur la Défense qui, tout en rappelant le caractère défensif de sa sécurité, revient sur le principe, adopté en 1976, de non-exportation d’armes, afin de pouvoir fournir aux Américains certains composants de leur « bouclier anti-missiles » commun. Pour la première fois, la Chine est également citée explicitement comme une menace potentielle, par elle-même et par ses visées sur Taïwan, distante d'une centaine de kilomètres seulement de l'île nippone la plus méridionale : les mouvements chinois sont considérés comme « à suivre attentivement », au même titre que ceux de la Corée du nord. En juillet 2014, l’article 9 finit par être modifié, pour permettre aux forces japonaises de participer à des systèmes de défense collective, telles que l’aide à un allié agressé ou la participation à des missions armées de l’ONU. En 2018, Tokyo confirme sa volonté de renforcer ses capacités militaires, vis-à-vis de Pyongyang mais aussi de la Chine et de la Russie, dont les incursions dans les espaces aérien et maritime nippons sont en augmentation, en raison notamment des contentieux qui les opposent respectivement au sud d’Okinawa et au nord d’Hokkaido (cf. Encadré infra sur les litiges maritimes). Le Japon procède au lancement de sa première brigade amphibie de déploiement rapide, équivalente aux « marines » américains, annonce la réalisation d’une nouvelle classe de destroyers et la transformation du plus gros de ses porte-hélicoptères en porte-avions, capable d’embarquer des aéronefs à décollage court. Le gouvernement préconise aussi de renforcer les coopérations avec d’autres pays (France, Inde, Australie), afin de mieux former les 247 000 membres de ses forces d’autodéfense à des opérations de longue durée ; le Japon a également initié, à la fin des années 2000, l'instauration d'un Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (dit Quad) avec les États-Unis, l'Inde et l'Australie, censé contrecarrer les ambitions chinoises dans l'Indo-Pacifique. En décembre 2022, sa nouvelle doctrine de sécurité nationale insiste sur la nécessité de doter le pays de « capacités de contre-attaque » permettant de frapper des sites potentiellement menaçants. Jusqu’alors gelées à 1 % du PIB, les dépenses militaires passeront à 2 % en 2027, l’accent étant mis sur la protection des côtes du sud-ouest, les plus proches de la Chine, décrite comme « le défi le plus grave » auquel Tokyo doive faire face. En novembre 2023, au nom des actions "d'autodéfense collective" que permet sa nouvelle doctrine, Tokyo renforce sa coopération militaire avec les Philippines, la Malaisie et le Bangladesh.

Des litiges maritimes avec tous les grands voisins
Outre ses différends avec la Russie sur les îles Kouriles (cf. article dédié) et avec les Chinois sur les îlots des Senkaku (cf. Les Senkaku, un archipel très convoité), le Japon revendique les rochers Liancourt (îles Dokdo pour la Corée du sud, Takeshima pour le Japon) situés en mer du Japon (ou mer de l’Est pour les Coréens) : ces minuscules 0,25 km² sont en effet au cœur d’une belle zone halieutique dont les fonds sont potentiellement riches en matières premières. Annexés par le Japon en 1905, lors de sa conquête de la péninsule coréenne, ils sont réinvestis après-guerre par la Corée du sud qui y installe quelques dizaines de soldats en 1954, puis un couple de pêcheurs plus tardivement. A l’été 2012, le Président sud-coréen devient le plus important officiel de Séoul à s’y rendre, ce qui provoque la fureur de Tokyo qui rattache ces terres à sa préfecture de Shimane.
Corée et Chine : les plaies mal refermées de l’occupation
Devenu un allié indispensable des États-Unis dans le contexte de la guerre froide, le Japon a été considéré comme victime de la guerre nucléaire et absous de la quasi-totalité de ses fautes. Ainsi, l’enseignement de l’histoire continue de passer sous silence les milliers de victimes des expérimentations bactériologiques réalisées sur des cobayes vivants par l’unité 731 (en Mandchourie), de même qu’il jette un voile pudique sur les 200 000 femmes chinoises, coréennes, philippines, indonésiennes ou néerlandaises enlevées puis violées, dans les années 1930-1940, pour le « réconfort » des soldats japonais.
Ce travail de mémoire n’a pas été opéré davantage en Corée du sud où plusieurs dirigeants de chaebol ont commencé à faire fortune lors de l’occupation japonaise et où les collaborateurs de l’occupant furent largement réintégrés en 1945 par le pouvoir pro-américain. Le dictateur Park Chung-hee, au pouvoir de 1961 à 1979 à Séoul, fut lui-même un officier de l’armée nippone.
En 1993, le porte-parole officiel du gouvernement japonais a formulé des excuses officielles pour l’exploitation des « femmes de réconfort » avant que, deux ans plus tard, le Premier ministre japonais présente des « excuses du fond du cœur » pour « le joug colonial et l’agression » infligés à la Chine et à la Corée. En revanche, ces actes de contrition ne donnent lieu à aucun dédommagement public, Tokyo considérant par exemple que la normalisation de ses relations avec Séoul, en 1965, a soldé tous les comptes avec la Corée du sud : celle-ci renonçait alors à exiger toute compensation, en échange de l’aide économique nippone, bien réelle, qui a permis à son économie de décoller spectaculairement.
Avec la Chine populaire, les relations diplomatiques ont été rétablies en 1972, suivies d’un traité de paix en 1978. Vingt ans plus tard, les officiels des deux pays publient une déclaration commune de « partenariat pour le XXIème siècle » mais, au grand dam de Pékin, les excuses formulées oralement par le Premier ministre japonais ne figurent pas dans la déclaration finale.
La méfiance est alimentée par des décisions ambigües du pouvoir japonais. En août 2001, le chef du gouvernement se rend au sanctuaire shinto de Yasukuni où, parmi les 2,5 millions « d’âmes » de morts pour la patrie, figurent celles des criminels de guerre. En 2005, l’édition de nouvelles versions de livres scolaires historiques provoque une importante vague anti-nippone en Corée du sud et surtout en Chine : le massacre de Nankin y est simplement qualifié d’incident, le sort des « femmes de réconfort » est passé sous silence et l’invasion menée dans les années 1930 est qualifiée de « guerre de la Grande Asie ».
Les relations avec Pékin se réchauffent en 2007 (avec la décision de mettre en place un « téléphone rouge » entre les armées des deux pays) et en 2008, avec la visite du Président Hu Jintao au Japon. Mais ces sujets restent inflammables, d’autant qu’ils comportent des différends territoriaux (cf. Encadré sur les litiges maritimes) et que le pouvoir nippon reprend une orientation très nationaliste à partir de 2013 : non seulement le nouveau Premier ministre conservateur ne formule aucune des excuses devenues de rigueur lors des cérémonies de la capitulation japonaise de 1945, mais il se rend au sanctuaire de Yasukuni. Pour la droite nippone, l’heure de la « diplomatie des excuses » est révolue. L’affaire provoque la suspension des sommets tripartites (Chine, Japon, Corée sud) tenus depuis 2008.
Ils reprennent fin 2015 et aboutissent notamment, sous la pression des Américains, à l’indemnisation par Tokyo des quarante-six « femmes de réconfort » encore vivantes. Rien n’est fait en revanche pour les descendantes des autres et l’armée impériale est exonérée de la responsabilité institutionnelle de cet esclavage sexuel. La question ressurgit début 2017, avec l’érection d’un monument en hommage à ces femmes devant le consulat du Japon à Busan, en plus de la statue commémorative trônant déjà devant l’ambassade japonaise à Séoul. L’année suivante, le nouveau gouvernement progressiste de Séoul remet en cause l’accord d’indemnisation de 2015, avant que la Cour suprême ne condamne deux conglomérats nippons à indemniser des travailleurs sud-coréens employés de force durant la deuxième Guerre mondiale. En décembre 2018, la dégradation des relations entre les deux pays est illustrée par un incident naval entre un destroyer sud-coréen et un avion de surveillance maritime japonais en mer du Japon (mer de l’Est). Par ricochet, Tokyo prend, en août 2019, des mesures de rétorsion commerciale contre son voisin, avant une nouvelle condamnation : en janvier 2021, la justice condamne l’État japonais à indemniser des « femmes de réconfort ». Mais, face au poids croissant pris par la Chine dans la zone Indo-Pacifique, les États-Unis poussent au rapprochement de leurs deux principaux alliés régionaux. Après proposé un plan de dédommagement des victimes de la colonisation nippone, le Président sud-coréen se déplace en visite officielle au Japon en mars 2023, premier sommet du genre depuis douze ans. La Corée du nord y répond par le tir d'un énième missile balistique.
Les relations entre Tokyo et la Corée du nord n’ont jamais été normalisées. En 2002, un Premier ministre japonais se rend pour la première fois au Nord et y présente, par écrit, ses excuses et remords pour l’occupation de la Corée, tandis que Pyongyang reconnaît l’enlèvement de onze jeunes Japonais (la plupart décédés) par ses services, à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Des négociations de normalisation s’ouvrent même en Malaisie, incluant la fixation d’une aide japonaise au titre de réparations de guerre, mais elles achoppent rapidement : le régime nord-coréen refuse notamment tout séjour au Japon des familles des séquestrés ou bien des quelques centaines de Japonaises qui se sont mariées à des Nord-Coréens et n’ont jamais pu revoir leur famille ni leur pays.
