9 833 517 km²
République fédérale présidentielle
Capitale : Washington[1]
Monnaie : dollar américain
342 millions d’habitants (Américains)
Date d’indépendance : 1776
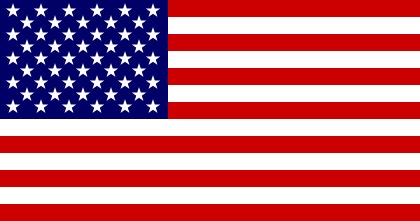
Les bandes blanches et rouges représentent les treize États initiaux et les cinquante étoiles sur fond bleu les États actuels.
[1] Washington n’est que la vingtième ville du pays, loin derrière New-York, Los Angeles, Chicago…
Pour l’histoire antérieure, lire L’Amérique du nord avant les indépendances modernes

Les États-Unis partagent 12 002 km de frontières terrestres avec deux pays : 8 891 avec le Canada au nord (dont 2 475 km en Alaska) – soit la plus longue frontière du monde entre deux États – et 3111 km avec le Mexique au sud. S’y ajoutent 28 km avec Cuba (sur la base navale de Guantánamo, cf. Particularismes étatiques). Le territoire continental des États-Unis compte 19 924 km de côtes sur les océans Pacifique à l’ouest, Arctique (au nord de l’Alaska), Atlantique à l’est et sur le golfe du Mexique au sud-est.
Avec ses multiples dépendances océaniennes et caribéennes (environ 10 500 km², dont les États associés de Porto-Rico dans les Antilles et des Mariannes du nord en Océanie, cf. Particularismes géopolitiques), le pays possède la plus grande zone économique exclusive du monde (11,3 millions de km²). Quelques différends frontaliers l’opposent à d’autres États : le Canada et les Bahamas sur quelques portions de frontières maritimes, Haïti au sujet de l’île de la Navasse et les Marshall au sujet de celle de Wake (cf. Territoires disputés).
De treize à l’indépendance (représentés par le nombre de bandes sur le drapeau), le nombre d’États fédérés américains est passé à cinquante (comme le nombre d’étoiles). Les derniers à avoir acquis ce statut sont l’Alaska et Hawaï en 1959, précédés de l’Arizona en 1912. Les 48 États fédérés contigus (ainsi que le district de Columbia, siège de la capitale) constituent le « Mainland ». Ils s’étendent sur 4 280 km d’est en ouest et sur 2 500 km du nord au sud. L’Alaska (capitale Juneau) est distant d’environ 4 500 km(mais d’un peu plus de 80 km seulement de la Russie sibérienne, dont il est séparé par le détroit de Béring) : avec une superficie de 1 717 854 km2 (incluant la quasi-totalité des îles Aléoutiennes[1]), l’Alaska constitue le plus grand des États américains (plus vaste à lui seul que les trois suivants réunis : Texas, Californie et Montana), mais aussi un des moins peuplés (730 000 habitants). Le cinquantième État fédéré ne se trouve pas sur le continent américain mais en Océanie,à plus de 3 700 km des côtes états-uniennes les plus proches : l’archipel polynésien d’Hawaï (16 649 km², 1,4 million d’habitants, capitale Honolulu) compte une centaine d’îles et îlots, dont dix-neufs îles et atolls principaux.
Dates d’adhésion : https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/USA-Union-ordre_d%27entree.htm
Le relief du « Mainland » est constitué d’une vaste plaine centrale, drainée par l’ensemble fluvial du Mississippi et du Missouri et ouverte, au nord-est, sur les Grands Lacs (245 000 km², en partie à cheval sur le Canada) qui communiquent avec le fleuve Saint-Laurent. A l’est, se trouvent les collines du piémont, puis les montagnes Appalaches (qui culminent à près de 2 040 mètres d’altitude) et à l’ouest les montagnes Rocheuses (culminant à plus de 4 400 m), la chaîne des Cascades et la Sierra Nevada qui encadrent des vallées, des plateaux et des bassins d’altitude. En Alaska, dominent les montagnes (avec un point culminant à 6 190 m) et les volcans, également actifs à Hawaï. Le climat des États-Unis est majoritairement tempéré, mais diffère dans certaines régions : tropical en Floride et à Hawaï, semi-aride dans les grandes plaines à l’ouest du Mississippi, aride au sud-ouest, méditerranéen en Californie, océanique au nord-ouest et arctique en Alaska.
[1] Vendues par la Russie aux États-Unis en 1867 (en même temps que l’Alaska), les Aléoutiennes (17 666 km²) se prolongent, jusqu’à la péninsule du Kamtchatka, par les îles du Commandeur qui, elles, sont demeurées russes. Cf. Iles et archipels divisés.
Près de 62 % des Américains sont de race blanche, dont près de 19 % de culture hispanique. Ils devancent les Noirs et Afro-américains (plus de 12 %), les Asiatiques (6%) et les autochtones Amérindiens, Inuits et Hawaïens (1,3 %). Environ 8 % des habitants déclarent appartenir à d’autres catégories et 10 % à au moins deux races. A peine la moitié des « Native » (membres des 574 nations reconnues : Cherokees, Navajos, Choctaws, Sioux…) vit au sein de plus de trois cents réserves et seule la langue navajo est aujourd’hui parlée par plus de 100 000 personnes. Très majoritairement originaires du Mexique (devant les Porto-Ricains résidant sur le sol états-unien et les Cubains d’origine), les Hispaniques sont la communauté qui contribue le plus à la croissance démographique américaine. Jusqu’à mars 2025, les États-Unis n’avaient pas de langue fédérale officielle, une quarantaine de millions de personnes pratiquant régulièrement l’espagnol ; ce rôle était joué de facto par l’anglais (langue officielle de trente-deux des cinquante États fédérés) qui est devenue la seule langue fédérale de jure à la faveur d’un décret présidentiel. L’hawaïen possède ce statut dans l’archipel d’Hawaï, ainsi que vingt langues autochtones en Alaska.
Sur les 77 % d’habitants déclarant une religion, environ 70 % sont chrétiens, dont plus de 46 % appartenant à différentes confessions protestantes (évangéliques 25 %, églises afro-américaines 6,5 %…) ; le reste se répartit entre 21 % de Catholiques et 3 % de membres d’Églises diverses (tels les Mormons qui représentent 60 % des habitants de l’Utah, les Témoins de Jéhovah, les Orthodoxes…). Les Juifs sont un peu moins de 2 % et les autres religions (islam, bouddhisme, hindouisme…) comptent moins d’1 % de pratiquants.

Dès leur indépendance, les États-Unis se mettent en quête d’une capitale qui ne soit pas trop grande (de façon à constituer un district fédéral indépendant des États) et qui soit globalement située entre les États du Nord et ceux du Sud. Le siège du pouvoir se déplace ainsi de Philadelphie à New-York et de Trenton à Annapolis, jusqu’à la décision de construire une ville nouvelle sur les rives du Potomac. Inaugurée officiellement en 1801, elle prend le nom du premier Président américain : Washington.
A peine constitués, les États-Unis s’affirment sur la scène internationale. Entre 1801 et 1815, ils mènent leurs premières actions armées extérieures, en l’occurrence en Méditerranée : les guerres barbaresques sont destinées à protéger les navires américains contre les pirates qui les capturent et réduisent leurs marins en esclavage. En parallèle, le territoire des États-Unis s’agrandit vers l’ouest. En 1803, Napoléon Bonaparte leur vend les deux millions de km² de Louisiane occidentale (le long de la vallée du Mississippi), que la France avait rachetée à l’Espagne trois ans plus tôt en promettant de ne pas la revendre à l’Angleterre ou aux Américains : mais le Français outrepasse cette promesse, ayant besoin d’argent pour mener à bien sa conquête de l’Europe. C’est aussi pour des raisons financières que, en 1819, les Espagnols cèdent les 200 000 km² de la Floride, territoire incontrôlable passé aux mains de bandits et d’esclaves en fuite. Quatre ans plus tard, le Président Monroe énonce une doctrine qui exclut toute influence européenne en Amérique (et réciproquement).
Au sud, le Texas proclame son indépendance du Mexique en 1836, avec la volonté de rejoindre les États-Unis d’Amérique. D’abord réticente, pour ne pas froisser son voisin méridional, l’administration américaine finit par incorporer la république texane en 1845. Considérant qu’il s’agit d’une violation d’accords passés neuf ans plus tôt, Mexico exige alors que sa frontière avec le Texas ne soit pas établie sur le río Bravo del Norte (río Grande pour leurs voisins), mais sur le Rio Nueces, 300 km plus au nord, ce qui déclenche une guerre entre les deux pays. Envahi par les Américains, le Mexique doit signer (en 1848) un traité qui impose le río Bravo comme frontière (sur 2 000 de ses 3 000 km) et l’oblige à céder plus de 40 % de son territoire à son vainqueur, soit environ un million et demi de km² comprenant les États actuels de Californie, du Nouveau-Mexique, d’Arizona, du Nevada, d’Utah, ainsi qu’une partie du Colorado, de l’Oklahoma, du Kansas et le sud-ouest du Wyoming.
Les États-Unis s’agrandissent aussi au Nord-Ouest : en 1846, Washington et Londres se partagent le territoire de l’Oregon, à l’ouest des montagnes Rocheuses, la partie septentrionale formant la Colombie britannique. Enfin, en 1867, la Russie — à la recherche d’argent — vend l’Alaska et ses établissements sur le Pacifique aux Américains, qui veulent empêcher les Britanniques d’étendre leur territoire canadien.
Poussés par le « Mythe de la Frontière », les Américains font la guerre aux Amérindiens et s’étendent vers l’Ouest. Remettant en cause la Proclamation royale britannique — qui attribuait aux Indiens la région située entre le Mississippi et la chaîne des Appalaches — le Congrès prévoit la déportation des autochtones à l’ouest du fleuve : suivant « la piste des larmes », les Indiens du sud-est (Choctaws, Creeks, Chickasaws, Cherokees) sont contraints de s’installer dans un Territoire indien qui correspond à l’actuel Oklahoma. A partir du milieu du XIXe siècle, la ruée vers l’or accélère la colonisation blanche. En 1859, la découverte des plus importants filons d’argent de l’histoire provoque l’afflux d’aventuriers dans le Nevada.
L’intégration des nouveaux territoires est facilitée par la construction du premier chemin de fer transcontinental (1869), mais cet afflux de colons à la recherche de terres envenime les relations avec les peuples Amérindiens. C’est notamment le cas en Floride, où l’expansion des plantations coloniales se heurte à la résistance des Séminoles, une communauté composée d’Amérindiens de plusieurs États, souvent issus de la nation Creek, mais aussi d’Afro-Américains fuyant l’esclavage de Géorgie. Malgré trois guerres (entre 1817 et 1858), les révoltés ne seront jamais totalement vaincus, à l’inverse des Sioux Lakota, battus en 1876-1877 sur leurs terres sacrées des Black Hills (Montana, Dakota et Wyoming actuels), où de l’or a été découvert.
Le conflit illustre les divisions entre Indiens : menés par Crazy Horse et Sitting Bull, les Lakotas sont soutenus par les Cheyennes et les Arapahos, tandis que les Shoshones, les Crows et les Pawnees combattent aux côtés des Américains. En 1876, le général Custer et la moitié de ses hommes sont tués à Little Big Horn, mais le dernier mot reviendra aux colons : la conquête de l’Ouest s’achève en décembre 1890, avec le massacre de Lakotas à Wounded Knee au sud-Dakota. De 1778 à 1871, le Congrès des États-Unis a signé (et violé) trois cent soixante dix traités avec les Indiens. Les guerres indiennes aux États-Unis et au Canada font environ 30 000 victimes parmi les « Premières Nations » et 19 000 dans les rangs Européens. Le Territoire indien dans les années 1890 (pour devenir l’État d’Oklahoma en 1907), tandis que la population autochtone s’est considérablement réduite (elle est passée de 18 millions au XVIIe siècle à moins de 2 millions).
Le conflit suivant résulte de l’abolition de l’esclavage. Interdit entre 1777 et 1804 dans les États du Nord, il le devient en 1808 au niveau fédéral mais reste pratiqué dans les États du Sud. Lorsque Abraham Lincoln, candidat du parti républicain (antiesclavagiste), remporte l’élection présidentielle de 1860, sept États sudistes (bientôt rejoints par quatre autres) font sécession et forment les États confédérés d’Amérique. Commencée l’année suivante, la guerre de Sécession se termine au printemps 1865, à l’avantage des États du Nord, au prix de très lourdes pertes (environ 3 % de la population américaine) : des dizaines de milliers de victimes civiles (le nombre précis est toujours inconnu) et 20 % des effectifs militaires engagés soit 620 000 soldats (360 000 dans les rangs de l’Union et 260 000 dans ceux des Confédérés, peut-être plus). S’y ajoute le Président Lincoln assassiné par un esclavagiste radical. Après cette victoire, trois nouveaux amendements à la Constitution sont votés pour abolir l’esclavage, libérer les quatre millions d’esclaves, leur donner la citoyenneté et le droit de vote.
Mais, dans les États du Sud, ces libertés sont entravées par les lois « Jim Crow » (surnom péjoratif donné aux Afro-Américains) : au nom du principe « égaux mais séparés« , elles introduisent la ségrégation raciale dans les services publics (écoles, hôpitaux, transports, justice, etc.) et dans les lieux de rassemblement (restaurants et cafés, salles de spectacle, salles d’attente, stades, toilettes…). Ces lois ne seront abolies qu’entre 1964 et 1968, sous la pression du mouvement des droits civiques, mené notamment par le pasteur Martin Luther King (qui mourra assassiné en 1968). La reconnaissance des droits des Indiens sera plus longue : elle se fait par étapes, en 1924 (attribution de la citoyenneté), 1934 (restitution de terres), 1961 et 1974 (autogestion des aides accordées par le gouvernement fédéral).
La nature du peuplement des États-Unis change profondément au cours des soixante années suivant la guerre de Sécession. La population passe de 5 millions en 1800 à 23 en 1850 et 76 en 1900. Le pays accueille des immigrés d’abord majoritairement protestants (Allemands, Britanniques, Scandinaves), puis catholiques (deux millions d’Irlandais victimes de la famine du milieu du XIXe siècle, mais aussi des Italiens, des Polonais) ; s’y ajoutent des Juifs d’Europe centrale, des Mexicains (en Californie et au Texas), des Japonais sur la côte Pacifique via Hawaï etc.
En 1898, l’archipel océanien d’Hawaï est devenu territoire états-unien, cinq ans après qu’un groupe de planteurs et de missionnaires américains a provoqué la déposition de la reine en exercice et son remplacement par une république fantoche. La même année, les États-Unis déclarent la guerre à l’Espagne, à la suite de la révolte de Cuba contre la tutelle espagnole, révolte qui menace l’approvisionnement des Américains en sucre cubain. Battue, Madrid doit céder Porto Rico à Washington, ainsi que Guam (dans le Pacifique) et les Philippines ; inspirée par les guerres indiennes, l’armée américaine y crée des camps de regroupement de civils, entre 1899 et 1902, pour mettre fin à l’insurrection des Philippins. Madrid doit également reconnaître l’indépendance cubaine. Celle-ci devient effective en 1902, quand les Américains mettent fin à plus de trois ans d’occupation, tout en y maintenant une présence : en 1903, ils acquièrent un bail incessible sur le camp de Guantánamo, au sud-est de Cuba, dont les 121 km² ont depuis été transformés en prison de haute sécurité pour des « combattants illégaux » capturés à travers le monde. En 1917, Washington rachète aussi les Indes occidentales danoises, rebaptisées îles Vierges américaines.
Considérant le bassin des Caraïbes comme leur « arrière-cour », les États-Unis vont y intervenir à de multiples reprises, au nom de la doctrine Monroe et de celle « du gros bâton » du Président Theodore Roosevelt (au début du XXe siècle). En 1903, ils fomentent une révolte au Panama, pour le détacher de la Colombie et pouvoir y construire un canal interocéanique, qui restera leur propriété jusqu’à la fin de l’année 1999 (cf. Particularismes politiques). Entre 1909 et 1933, ils interviennent à plusieurs reprises au Nicaragua, en proie à des soulèvements populaires contre les gouvernements en place. De 1915 à 1934, ils sont à Haïti pour mettre fin à des révoltes paysannes.
Devenus la première puissance économique mondiale –en dépit de la grave crise traversée dans les années 1930 – les États-Unis jouent également un rôle déterminant dans la victoire contre les Allemands et leurs alliés durant les deux Guerres mondiales, bien qu’engagés tardivement dans les conflits (respectivement en 1917 et 1942). Au surlendemain du second, en 1949, Washington promeut la fondation de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), alliance défensive qui compte à ce jour une trentaine de membres. La lutte contre le communisme devient un élément fondamental de la politique de Washington (y compris à l’intérieur avec le maccarthysme au début des années 1950), a fortiori quand les intérêts économiques des États-Unis sont menacés. Elle se manifeste par des interventions massives dans la guerre de Corée de 1950 à 1953 (cf. Le monde coréo-mandchou), le renversement du Président guatémaltèque en 1954, l’aide apportée à la tentative ratée de renversement de Fidel Castro en 1961 à Cuba (sous embargo américain depuis), la guerre du Vietnam de 1961 à 1973 (cf. Vietnam), le renversement du Président socialiste chilien en 1973 (par des militaires formés à l’École des Amériques, fondée en 1946 au Panama). En 1983, des troupes américaines débarquent dans l’île de Grenade, après l’assassinat du Président par des militaires pro-soviétiques. Six ans plus tard, ils capturent le Président panaméen, impliqué dans du narco-trafic.
Au cours des années 1990, les forces de Washington interviennent, sous couvert de l’OTAN, dans les différentes guerres qui ont éclaté en Yougoslavie socialiste. La volonté de contrecarrer l’influence de l’URSS se manifeste aussi par des interventions indirectes des services secrets américains, en soutien aux dictatures brésilienne (1964-1985) et chilienne (de 1973 à 1990) ou pour la livraison d’armes à divers mouvements à travers le monde, tels que les contras du Nicaragua (basés au Honduras) et certains moudjahidines d’Afghanistan. Cf. ces différents pays.
L’engagement des États-Unis dans ce dernier pays lui vaut d’être pris pour cible par l’organisation islamiste internationale Al-Qaida. En septembre 2001, quatre attentats-suicides quasi-simultanés tuent près de trois mille personnes en Virginie, en Pennsylvanie et surtout dans les tours jumelles du quartier new-yorkais de Manhattan. La « guerre contre la terreur » décrétée alors par le Président américain conduit les forces de Washington à intervenir contre les talibans afghans. En 2003, elles envahissent l’Irak (sans accord de l’ONU), après une première intervention qui était destinée, en 1991, à libérer leur allié koweïtien envahi par les troupes de Bagdad : cette fois, il s’agit de déposer le dictateur Saddam Hussein, sous le prétexte (inexact) qu’il cherchait à se doter d’armes de destruction massive. La lutte contre le djihadisme conduit par ailleurs le gouvernement américain à intervenir militairement contre l’organisation État islamique en Irak et en Syrie, à partir de 2014, et à frapper les rebelles Houthis du Yémen (cf. ces pays).
Le retour au pouvoir du Président républicain Trump, en 2025, a remis au premier plan les ambitions hégémoniques des États-Unis. Tenant du MAGA (« Make America great again »), il déclenche une guerre douanière contre la plupart des partenaires commerciaux du pays, engage l’expulsion de milliers d’immigrants (dont des centaines de délinquants envoyés dans les prisons de l’allié salvadorien) et revendique l’annexion du canal de Panama, du Groenland danois et même du Canada (pourtant membre de l’OTAN, comme le Danemark). En mars 2025, l’anglais est instauré seule langue officielle du pays : les agences fédérales n’auront plus l’obligation de fournir des services dans d’autres langues (bien qu’étant toujours autorisées à le faire).
En août, le Président signe un décret autorisant le recours à la force contre les cartels mexicains de la drogue, le gang vénézuélien Tren de Aragua et le Cartel de los Soles, prétendument dirigé par de hauts dignitaires de Caracas. Au prétexte de lutter contre leurs trafics, plusieurs milliers de marines et des bâtiments de guerre sont déployés dans les Caraïbes et même dans le Pacifique. Présentées comme servant aux trafiquants, des embarcations (y compris un petit sous-marin) sont coulées dans les eaux internationales situées au large du Venezuela, de la Colombie, de l’Équateur et du Mexique. Mais, n’étant pas à une contradiction près, Trump gracie l’ancien Président hondurien Hernandez (condamné à 45 ans de prison pour trafic de drogue), alors que des élections générales se déroulent au Honduras.
En novembre 2025, le pays connait une sensation politique avec l’élection, comme maire de New-York, d’un démocrate anti-système et anti-Trump : trentenaire et d’origine indienne, il est le premier musulman et le premier socialiste revendiqué à diriger la plus grande ville et capitale financière des États-Unis. Le Président américain subit également un revers en Californie, dont le gouverneur démocrate fait approuver par référendum la création de cinq nouveaux sièges de députés, en compensation des cinq supplémentaires créés en août précédent dans le très républicain État du Texas.
En décembre 2025, la nouvelle « Stratégie de défense nationale » publiée par l’administration Trump redéfinit la vision américaine du monde : un partage en zones d’influence états-unienne (dont le continent américain et l’Indo-Pacifique), chinoise et russe. Le mois suivant, le Pentagone exhorte les alliés des États-Unis (à commencer par les Européens) à prendre en main leur propre sécurité et réaffirme l’importance accordée par l’administration Trump à la sécurité intérieure du pays et à la dissuasion vis-à-vis de la Chine. En liaison directe avec cette définition — qui exclut toute présence russe ou chinoise en Amérique — des troupes américaines effectuent une impressionnante opération aéroportée, au début du mois de janvier 2026, sur le sol du Venezuela, dont ils capturent le Président (cf. ce pays). Le prétexte officiel est de mettre fin au trafic de cocaïne et de fentanyl passant par le sol vénézuélien, dont le volume est en réalité faible ; la véritable raison est de remettre la main sur un pays, très lié à la Russie et à la Chine, qui possède les plus importantes réserves pétrolières du monde. Quelques jours plus tard, les forces du ministère de la Défense (rebaptisé ministère de la Guerre) arraisonnent deux pétroliers accusés de violer le blocus naval sur le pétrole vénézuélien : l’un d’eux, lié à l’Iran et au Hezbollah avant d’être récemment immatriculé en Russie, est intercepté dans la zone économique de l’Islande, avec l’appui des Britanniques, alors qu’il naviguait à vide vers Caracas.
Pour en savoir plus sur les interventions militaires américaines : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interventions_militaires_des_%C3%89tats-Unis_dans_le_monde
Photo : la Maison Blanche à Washington
