243 610 km²
Monarchie constitutionnelle
Capitale : Londres
Monnaie : livre sterling
68,5 millions habitants (Britanniques)
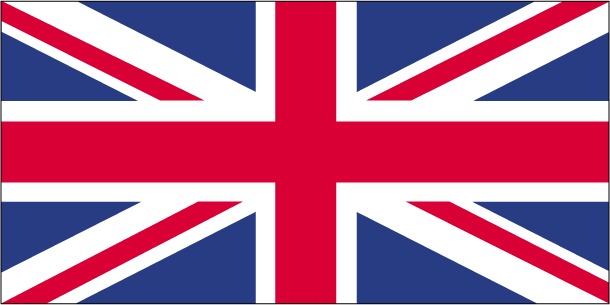
Apparu en 1801, le drapeau (Union Jack) résulte de la fusion de la croix de Saint-Patrick irlandaise avec la croix de Saint-Georges anglaise et la croix de Saint-André écossaise (le dragon rouge gallois n’y apparaît pas, le Pays-de-Galles étant assimilé à l’Angleterre)
Voir aussi : L’histoire des îles britanniques

Le Royaume-Uni est constitué de quatre nations. Trois sont situées sur les 229 850 km² de l’île de Grande-Bretagne : l’Angleterre (53 % de la superficie du royaume), l’Écosse (32 %) et le Pays de Galles (9 %). La quatrième est l’Irlande du nord, qui occupe 17 % de l’île irlandaise (et représente 6 % du royaume). Le pays compte 12 429 km de côtes sur l’océan Atlantique au nord, la mer d’Irlande à l’ouest, la mer du Nord à l’est et la Manche (Channel) au sud. Sa seule frontière terrestre (499 km) est avec la république d’Irlande.
Le relief est formé de plaines (à l’est et au sud-est), de collines et de basses montagnes (culminant à 1 345 m en Écosse). Le climat est tempéré.
87 % de la population est constituée de Blancs européens. Les Noirs (d’origine africaine ou caribéenne) sont environ 3 %, les Métis 2 % et les Asiatiques 7 % (un peu plus de 2 % d’Indiens et un peu moins de Pakistanais).
La langue officielle est l’anglais, le gaélique écossais et le gallois bénéficiant de ce statut dans leurs régions respectives, de même que le gaélique irlandais et le scots en Irlande du nord. Une autre langue celtique est parlée par quelques milliers de personnes en Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre) : le cornique, proche du gallois et du breton de Cornouaille (sans « s »).

Sur 62 % d’habitants déclarant une religion, plus de 46 % se disent chrétiens et 6 % musulmans. Les autres sont hindous (1,6 %), sikhs (0,8 %), juifs, bouddhistes… Le christianisme se partage entre l’anglicanisme (ayant le statut de religion établie en Angleterre, le chef de l’Église étant le souverain britannique) et le presbytérianisme (religion nationale écossaise), ainsi que le méthodisme et le catholicisme en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord.

D’une superficie de 78 772 km², l’Écosse (Alba en gaélique écossais) compte environ 5,5 millions d’habitants (8 % de la population britannique). Sa capitale est Édimbourg et sa ville principale Glasgow.
Depuis 1970, l’enseignement y est bilingue, bien qu’en pratique la seule langue véritablement parlée soit l’anglais écossais ; le gaélique écossais (1 % de locuteurs) n’est vraiment employé que dans les Hébrides. Survivent également un dialecte hérité du moyen anglais (le scots) et les traces d’un ancien dialecte scandinave (le norne) aux Shetland et aux Orcades. Un peu plus de la moitié des 63 % d’Écossais déclarant une religion sont chrétiens : environ 32 % appartiennent à l’Église presbytérienne d’Écosse et 16 % sont catholiques.

S’étendant sur un peu moins de 20 800 km², le Pays de Galles (Cymru en gallois) compte environ 3,2 millions d’habitants (moins de 5 % de la population du Royaume-Uni), dont au moins un quart « d’immigrants » anglais. Sa capitale est Cardiff, sur la côte méridionale.
Reconnu comme « langue nationale » aux côtés de l’anglais, le gallois (obligatoire à l’école jusqu’à seize ans) est parlé par plus de 20 % de la population : très peu pratiqué dans le Sud industriel, il l’est en revanche beaucoup plus dans le Nord et l’Ouest. Un peu plus de 55 % de la population se dit chrétienne, les anglicans devançant les catholiques et les méthodistes.
Depuis 1998, les trois nations non-anglaises constitutives du royaume bénéficient d’un régime de « dévolution » leur accordant une autonomie législative et exécutive dans un nombre plus ou moins étendu de domaines. Adoptée à une courte majorité, la dévolution galloise est moins large que celle des autres et n’est pas remise en question. Elle l’est en revanche en Écosse, dont l’exécutif est dirigé par le Scottish National Party (SNP). En 2014, les nationalistes écossais organisent un référendum, légal, sur l’indépendance, qui voit le rejet de l’option souverainiste : 55 % des votants se prononcent en faveur de l’appartenance écossaise au Royaume-Uni, bien qu’ils souhaitent davantage d’autonomie fiscale. La seule grande ville à voter en faveur de l’option indépendantiste est Glasgow. Les Écossais rappellent néanmoins leur particularisme : en 2015 (lorsque le SNP remporte la quasi-totalité des sièges attribués à l’Écosse au Parlement de Westminster) et en 2016, en votant à 62 % en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne (alors que les Anglais et la majorité des votants du Pays de Galles – à l’exception de ceux du Nord-Ouest – se sont majoritairement prononcés en faveur de la sortie, le Brexit). Bien que concurrencé par un nouveau parti nationaliste (Alba, fondé par l’ancien chef du SNP) et par les Verts indépendantistes, le SNP reste omniprésent en Écosse : en 2021, il frôle la majorité absolue à Holyrood (le Parlement d’Édimbourg).
Voté en 1949 par le parlement britannique, après la proclamation de la république d’Irlande (Eire), l’Ireland Act stipule que le statut des six comtés septentrionaux de la province d’Ulster, au nord de l’île, ne pourra être modifié sans l’accord de ses habitants. Sur le plan institutionnel, un Parlement d’Irlande du Nord exerce le pouvoir législatif local. Au milieu des années 1960, la question de l’unification avec la république d’Irlande refait surface chez les catholiques – nationalistes et républicains – qui réclament surtout la fin des discriminations économiques et sociales dont ils sont victimes de la part des protestants. Redoutant que les comtés du nord de l’Ulster ne sortent un jour du giron britannique, les loyalistes – ou unionistes – organisent des milices telles que l’Ulster Volunteer Force (UVF). En 1966, elle commet un premier acte de violence (l’assassinat d’un civil catholique) qui va être suivi de beaucoup d’autres, la police nord-irlandaise (la RUC, Royal Ulster Constabulary) apportant son soutien aux loyalistes. En 1969, l’envahissement d’un ghetto catholique de Londonderry (Derry pour les catholiques) provoque des émeutes mortelles. Appelée à intervenir, l’Eire ne répond que par l’envoi d’aide humanitaire et quelques initiatives diplomatiques sans lendemain. Les « troubles » incitent en revanche une partie de l’IRA (Armée républicaine irlandaise, fer de lance de la guerre d’indépendance) à reprendre les armes qu’elle avait déposée en 1962. Cette aile militariste prend le nom d’IRA provisoire, par rapport à la direction qui reste sur une ligne essentiellement politique (et prend le nom d’IRA officielle). Renforcée par de nouvelles recrues, l’organisation se lance dans des actions de guérilla, urbaine et rurale, qui gagnent la capitale Belfast et toute la province. Les protestants les plus radicaux ripostent en créant le Parti unioniste démocrate (DUP, scission du vieux Ulster unionist party, UUP, fondé en 1905) ainsi que l’Ulster Defence Association (UDA / Ulster freedom fighters) qui va devenir le plus important groupe paramilitaire loyaliste.

L’Ulster banner n’est plus utilisée depuis 1972, sauf par les loyalistes, ainsi que par les sportifs nord-irlandais dans certaines compétitions.
La violence atteint son paroxysme en 1972, année qui débute par le Bloody sunday à Derry : le 1er bataillon parachutiste y tire sur une marche pacifique de 20 000 personnes désarmées, faisant 14 victimes. L’Irlande du nord passe sous administration directe de Londres (Direct rule), en même temps que des solutions sont recherchées avec l’Eire pour mettre fin au conflit. Mais elles capotent en 1974, après que l’UVF – sans doute aidée par certains services britanniques – a fait sauter quatre voitures piégées en Irlande du sud, causant la mort de vingt-huit personnes. La même année apparaît une nouvelle organisation républicaine radicale, l’Irish National Liberation Army (INLA), branche armée de l’Irish Republican Socialist Party (issu du Sinn Féin, la vitrine officielle de l’IRA). Soutenues par la diaspora irlandaise et armées via différentes filières (notamment par la Libye), les organisations catholiques s’en prennent à des cibles de plus en plus grosses, telles que le Congrès du Parti conservateur de Margaret Thatcher en 1984 (cinq morts) et le siège du Premier ministre à Londres en 1991.
Une solution militaire apparaissant lointaine, les gouvernements britanniques et irlandais engagent des pourparlers avec le Sinn Féin et les modérés de chaque camp (Social-Democratic and Labour party, SDLP, côté catholique et UUP côté loyalistes). Ils aboutissent, en 1998, aux « accords du Vendredi saint » qui sont approuvés par référendum au Sud (94,5 %) et au Nord (77 % de oui, mais un vote négatif chez environ la moitié des protestants). Les violences ont fait plus de 3 500 morts, dont plus de 1 900 civils, un millier dans les rangs des forces de l’ordre, 360 au sein des diverses organisations républicaines et 150 parmi les milices loyalistes. Les accords rétablissent une Assemblée nord-irlandaise, dotée d’une large autonomie dans un certain nombre de domaines : santé, emploi, développement économique, environnement, transports, logement, justice, éducation, culture… Le gaélique irlandais (connu par environ 10 % des Nord-Irlandais) et le scots d’Ulster (dialecte anglo-frison, compris par environ 2 %) ont le statut de langues régionales.
En octobre 2006, la Commission internationale d’experts chargée de surveiller le désarmement de l’IRA conclut que l’organisation a démantelé toutes ses structures militaires, y compris d’entraînement et de fabrication d’engins explosifs. Quelques mois plus tard, le Sinn Féin reconnaît la légitimité du Police Service of Northern Ireland, successeur de la RUC et davantage ouvert aux catholiques. De 30 000 hommes au plus fort de la crise, les effectifs de l’armée britannique sont passés à 5 000 (comme avant le début des troubles) et les militaires ne patrouillent plus dans les rues. Bien qu’en net reflux, la violence ne disparait pas pour autant de la scène nord-irlandaise. Si l’IRA, l’INLA et d’autres groupes ont officiellement cessé le combat (pour se reconvertir parfois dans le banditisme et le trafic de drogue), quelques dizaines de leurs militants ont rejoint des groupuscules au sein desquels ils encadrent des jeunes plus ou moins marginalisés : IRA de la continuité, fondée dès 1986, IRA véritable et Nouvelle IRA, née en 2012. Elles commettent des actions épisodiques, dont la plus spectaculaire est l’attentat à la voiture piégée d’Omagh, perpétré après les accords du Vendredi saint (vingt-neuf morts). Côté loyalistes, la Force des volontaires loyalistes (LVF, dissidence de l’UVF) s’est dissoute en 2005. En revanche, l’UDA, l’UVF et le Red hand commando restent actifs et unis dans un Loyalist Communities Council (LCC). Les deux camps se livrent aussi à des opérations punitives contre les délinquants de leur propre communauté (tabassage ou tirs dans les genoux et les articulations).
En 2012, lors d’une visite en Irlande du nord, la reine d’Angleterre accepte de serrer la main du vice-Premier ministre nord-irlandais, qui était le chef militaire de l’IRA quand Lord Mountbatten, oncle de la souveraine, fut assassiné en 1979. Mais malgré ce genre de gestes, l’intégration des deux communautés reste en panne : à Belfast, une centaine de murs sépare encore les quartiers catholiques et protestants et, dans la province, seules 5 % des écoles sont de confession mixte. Cette ségrégation peut parfois dégénérer en violences, notamment lors des marches estivales de l’Ordre d’Orange, une société fraternelle protestante qui célèbre chaque année la victoire de Guillaume d’Orange sur Jacques II à la bataille de la Boyne en 1690 (cf. L’histoire des îles Britanniques).
Depuis 2016, le fonctionnement des institutions d’Irlande du Nord connait des perturbations. Les premières sont dues à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne : majoritairement hostile à ce Brexit (à 56 %, sauf dans ses districts majoritairement protestants du nord-est), l’Irlande du Nord a bénéficié d’aménagements destinés à faciliter les échanges de biens et de personnes avec l’Eire, restée membre de l’UE[1] ; ces arrangements – qui introduisent des contrôles douaniers en mer d’Irlande, donc une frontière commerciale entre la Grande-Bretagne et l’Ulster et pas entre les deux Irlande – sont considérés comme une violation de la souveraineté britannique par une partie des unionistes (dont le LCC). En avril 2021, ils donnent lieu à une flambée de violences dans les quartiers unionistes de Belfast et Derry, les jeunes manifestants étant suspectés d’être instrumentalisés par d’anciens paramilitaires devenus travailleurs sociaux.
Depuis 2022, les unionistes ne disposent plus de la large majorité qui était la leur au Palais de Stormont, du fait de l’évolution démographique régionale : selon le recensement de 2021, sur 1,8 million de nord-Irlandais (moins de 3 % de la population britannique), ceux ayant grandi dans la religion catholique (45,7 %) sont devenus plus nombreux que ceux élevés dans les cultes protestants[2], principalement presbytérien et anglican (43,5 %). Avec 40,5 % aux élections provinciales, les différentes formations unionistes conservent une courte avance sur leurs rivales républicaines (39,8 %), mais le premier parti est devenu le Sinn Féin (qui a progressé au détriment du SDLP), le reste des suffrages allant à l’Alliance nord-irlandaise (multiconfessionnelle). C’est donc la vice-Présidente du SF qui est chargée de former le nouvel exécutif, en partenariat avec le Parti unioniste démocrate (DUP) qui s’y refuse. Pour assouplir le protocole nord-irlandais, l’UE et le Premier ministre conservateur britannique trouvent un nouvel accord en 2023 : en vertu du « cadre de Windsor », les contrôles des marchandises débarquant dans le nord ne concerneront plus que celles destinées à l’Eire. L’année suivante, le Sinn Féin prend officiellement la tête de l’exécutif nord-irlandais, le DUP ayant mis fin à son boycott, qui bloquait le fonctionnement des services publics de la province.
[1] 30 000 travailleurs franchissent chaque jour les 490 km de frontière entre les deux Irlande.
[2] Au Sud, la population est catholique à plus de 68 % (contre moins de 4 % de protestants).
En juillet 2024, huit ans après avoir fait voter ses concitoyens en faveur du Brexit, le Parti conservateur enregistre sa pire défaite aux élections législatives britanniques. Concurrencé par la percée d’une formation ultranationaliste – Reform UK qui devient le troisième parti en voix du pays – il abandonne le pouvoir au Parti travailliste (gauche). Au pays de Galles, le Plaid Cymru, en hausse, frôle les 15 % de voix, tandis qu’en Ecosse, le SNP – avec moins de 30 % – perd 80 % de ses sièges au profit des travaillistes. En Irlande du Nord, nationalistes et unionistes obtiennent environ 40 % des voix chacun, mais neuf élus pour les premiers (dont sept pour le Sinn Féin) contre sept pour les seconds, du fait du recul du DUP (qui perd plus de 8 % au profit de ses rivaux plus radicaux, l‘UUP et la Voix unioniste traditionnelle TUV). L’Alliance obtient 15 %.
Photo : Londres vue depuis la cathédrale Saint-Paul
