756 102 km²
République présidentielle
Capitale : Santiago[1]
Monnaie : peso chilien
18,6 millions d’habitants (Chiliens)
Indépendance en 1818
[1] Le Parlement siège à Valparaiso
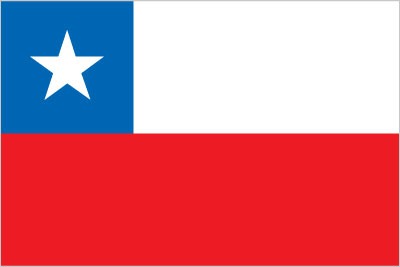
L’étoile représente l’unité de l’État, le bleu le ciel et l’océan Pacifique, le blanc les sommets enneigés des Andes et le rouge le sang versé pour obtenir l’indépendance du pays.
Pour l’histoire ancienne, lire L’Amérique du sud jusqu’aux indépendances modernes

Ouvert sur l’océan Pacifique à l’ouest (6 435 km de côtes), le Chili s’étire sur 4 300 kilomètres de long (et 180 km de large en moyenne), depuis le désert d’Atacama au nord jusqu’au cap Horn, le plus méridional du monde. Il partage 7 801 km de frontières terrestres avec trois pays : 168 avec le Pérou au nord, 942 avec la Bolivie au nord-est et 6 691 avec l’Argentine à l’est.
Le territoire chilien inclut les 164 km² de l’île polynésienne de Pâques (distante de plus de 3 500 km des côtes chiliennes) et les 100 km² de l’archipel Juan Fernández qui, à plus de 600 km du Chili, compte l’île ayant inspiré le roman Robinson Crusoé. Présent sur deux continents (Amérique et Océanie), le pays revendique aussi 1,5 million de km² au pôle sud, dont les 3 867 km² des îles Shetland du sud, également revendiquées par l’Argentine et le Royaume-Uni.
Le relief chilien est composé d’une étroite plaine côtière, d’une fertile vallée centrale et de la cordillère des Andes à l’est. La chaîne montagneuse, où culmine le plus haut volcan du monde (le Nevado Ojos del Salado à 6 893 m), sépare la Patagonie et la Terre de feu chiliennes de leurs homologues argentines (cf. Particularismes étatiques). Au nord, le désert d’Atacama (104 900 km²) est considéré comme une des zones les plus arides du monde, depuis au moins cinq millions d’années.
Le climat varie selon les zones : désertique tempéré au nord, méditerranéen au centre, polaire océanique frais et très humide au sud.
53 % de la population est composée de descendants d’immigrants européens et moyen-orientaux et 11 % d’Amérindiens, principalement Mapuches (« peuple de la terre », 9 %), mais aussi Aymaras, Quechuas, Diaguites, Rapa Nui de l’île de Pâques… Le reste de la population est métissée. La langue officielle est l’espagnol.
Sur 84 % d’habitants déclarant une religion (en 2014), 64 % sont catholiques, 17 % protestants évangéliques et 3 % adeptes d’autres confessions (Témoins de Jéhovah, Mormons, Juifs).

Après une première indépendance proclamée en 1810 (cf. Amérique du sud), le Chili n’accède à une totale souveraineté que huit ans plus tard, quand l’armée des Andes constituée avec les Argentins l’emporte sur les Espagnols. Les derniers soldats de Madrid, réfugiés sur l’île de Chiloé, au large du Chili central, sont définitivement chassés en 1826. La découverte de minerai d’argent et l’essor commercial du port de Valparaiso favorisent le développement économique du pays, qui entre en concurrence avec le Pérou pour déterminer lequel des deux détiendra la suprématie maritime sur le Pacifique. La rivalité prend une tournure conflictuelle lorsque les Péruviens forment une Confédération avec la Bolivie en 1837 : se sentant menacé, le Chili leur déclare la guerre et, après une victoire à Yungay, en 1839, parvient à obtenir que ses ennemis dissolvent leur alliance.
A partir de 1840, les Chiliens et leur voisin argentin se lancent à la conquête des régions du Sud (Pampa méridionale et Patagonie orientale) avec un objectif identique : s’en emparer pour se donner un accès à un deuxième océan, l’Atlantique pour le Chili et le Pacifique pour l’Argentine. Ces territoires, qui n’ont jamais été soumis par les Espagnols, sont en effet aux mains des semi-nomades Mapuches (Araucans) et des différents peuples « Patagons » qu’ils ont assimilés (« araucanisés »), de gré ou de force, entre les XVIIe et XIXe siècle. Pour intervenir militairement, le régime chilien prend prétexte d’une révolte des Mapuches, en 1859, contre la colonisation rampante de leurs terres et l’implantation d’Européens dans la région de Valdivia, c’est-à-dire sur leur flanc sud. Outre la volonté de sécuriser les colons chiliens déjà présents en Araucanie, Santiago ambitionne de s’emparer de nouvelles terres pour produire des céréales. Les préoccupations chiliennes sont d’autant plus grandes que, en 1860, un aventurier français (Orélie-Antoine de Tounens) a réussi à se faire couronner roi d’Araucanie et de Patagonie par des caciques Mapuches. Une fois le trouble-fête arrêté et expulsé, les Chiliens se lancent dans la « Pacification de l’Araucanie » qui, entre opérations militaires meurtrières et négociations avec certains clans Indiens, va durer jusqu’en 1883. Ayant perdu 90 % de leurs terres, les survivants sont regroupés dans des zones de faible superficie dénommées reducciones, le reste des terres étant déclaré bien national et vendu à de grands groupes, notamment forestiers, mais aussi à l’Église.
En revanche, le Chili doit renoncer à son projet d’annexer l’ensemble de la Patagonie : Buenos-Aires l’ayant menacé de s’allier à ses ennemis Boliviens et Péruviens, Asuncion est contraint de signer en 1881 le Traité des frontières, qui laisse à l’Argentine toute la zone située à l’est de la Cordillère des Andes. Depuis deux ans en effet, les Chiliens affrontent la Bolivie et le Pérou, après avoir envahi le port bolivien d’Antofagasta et sa région riche en salpêtre (matière qui sert alors à la fabrication des explosifs). Victorieux de cette guerre du Pacifique, en 1883, le Chili gagne 125 000 km² de côtes boliviennes (le long du désert d’Atacama) et 75 000 km² de territoire péruvien dans les régions méridionales de Tarapacá et Arica (celle de Tacna sera rendue au Pérou en 1929). L’affaire empoisonne toujours les relations entre Santiago et La Paz (cf. Bolivie). En 1888, le Chili achève son expansion territoriale par l’incorporation de l’île de Pâques.
En 1891, le conflit entre le président Balmaceda et le Congrès aboutit à une guerre civile, qui voit la victoire de la junte congressiste d’Iquique (nord du pays) et la mise en place d’une République parlementaire. Les années qui suivent sont marquées par une période de prospérité économique, qui suscite l’apparition de revendications en faveur d’une meilleure répartition des richesses (la Cuestión Social). En 1907, des grèves massives sont déclenchées par les ouvriers du salpêtre de la province de Tarapacá, qui se rassemblent à Iquique. Les négociations avec le patronat n’aboutissant pas, le président Pedro Montt envoie des troupes. La répression du mouvement fait entre 126 (bilan officiel) et 3 000 morts. L’élection du Président progressiste Alessandri Palma, en 1920, corrige certaines inégalités. Malgré l’opposition du Sénat, dominé par l’oligarchie conservatrice, il institue un code du travail, établit un impôt sur la rente foncière, crée des caisses de sécurité sociale, etc. En 1925, il promulgue une nouvelle Constitution qui restaure un régime présidentiel (mais en faisant élire le président au suffrage universel), déclare l’instruction primaire obligatoire et consacre la séparation de l’Église et de l’État ainsi que la liberté religieuse.
La crise du salpêtre (nitrate de potassium), doublée de la crise économique mondiale des années 1930, engendrent une forte instabilité politique, ponctuée de coups d’État dont l’un, en 1932, instaure une éphémère (douze jours) république socialiste. Le retour au pouvoir d’Alessandri permet de ramener le calme et de relancer l’économie, en particulier grâce à l’extraction de cuivre (qui remplace le nitrate) dans la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde à Chuquicamata (dans le désert d’Atacama). En 1938, les élections sont remportées par une coalition de gauche, le Front populaire (Frente de Acción Popular, dont les réformes sociales et politiques font du Chili un des pays les plus avancés du point de vue de la législation et de la protection sociale. Mais le processus est interrompu par la mort du Pedro Aguirre Cerda et par la seconde Guerre mondiale.
A la fin des années 1950, la vie politique s’organise autour de trois pôles : le Front populaire, la droite conservatrice et le Parti démocrate-chrétien (PDC). Celui accède au pouvoir en 1964 avec Eduardo Frei Montalva, qui entreprend une réforme agraire et une nationalisation de l’exploitation de cuivre, souvent gérée par des Américains. Six ans plus tard, les élections sont remportées par le socialiste Salvador Allende (candidat de l’Unité populaire, qui a succédé au Front) avec un peu moins de 37 % des suffrages, devant le candidat de la droite (35 %) et celui du PDC (28 %). Le scrutin ne comportant qu’un seul tour, l’élection d’Allende est validée par le Congrès, avec l’appui des démocrates-chrétiens. Poursuivant les réformes de son prédécesseur, notamment en matière de nationalisations, le nouveau chef d’État accentue la politique de redistribution des terres en faveur des paysans pauvres, lance un plan de grands travaux pour faire chuter le chômage, augmente les salaires, fait construire des logements ouvriers et restitue certaines de leurs terres ancestrales aux Mapuches. Mais cette politique s’avère d’autant plus coûteuse que les cours mondiaux du cuivre diminuent fortement et que les opposants déstabilisent l’économie, en fomentant notamment des mouvements sociaux (tels que la grève des camionneurs) et en soutenant des groupes d’extrême-droite qui affrontent sporadiquement les milices gauchistes du MIR (Mouvement de la gauche révolutionnaire, fondé en 1965). Inquiets que le Chili bascule dans le communisme, les États-Unis diminuent leur aide et soutiennent l’opposition légale, qui devient majoritaire au Parlement en 1973, quand les démocrates-chrétiens remportent les législatives alliés aux conservateurs. La même année, lorsque le chef d’État-major de l’armée chilienne démissionne, Allende le remplace par un général considéré comme loyal : Augusto Pinochet.
Pourtant, ce descendant d’une famille bretonne se joint, en septembre 1973, au coup d’État fomenté par les chefs de la marine et de l’armée de l’air. Bombardé dans son palais présidentiel, la Moneda, Allende préfère se suicider. Commence alors une période de répression des opposants par la dictature qu’instaure Pinochet : le stade national de Santiago sert de prison à ciel ouvert et d’autres prisonniers sont détenus et torturés dans des camps de concentration organisés à la hâte. Près de 2 300 personnes auraient été assassinées par la police politique (la Dina, Direction nationale du renseignement) et plus de 33 000 arrêtées et torturées entre 1973 et 1990, tandis que 500 000 à un million quittaient le pays. Prenant le contrepied de la politique des socialistes, Pinochet reprend les terres accordées aux Mapuches et confie l’économie à des adaptes de l’école ultralibérale de Chicago. La privatisation et la réduction des dépenses publiques provoquent une aggravation du chômage, de la pauvreté et des inégalités et l’économie ne commence à se redresser qu’au tournant des années 1970-1980 (période qualifiée de « miracle chilien » par les théoriciens libéraux) avant une nouvelle dégradation. Le retour à une relative prospérité ne survient qu’au début des années 1990.
Sur le plan international, le Chili participe activement à l’Opération Condor visant à éliminer physiquement les opposants aux dictatures militaires. Des partisans de la démocratie, en exil, sont assassinés partout dans le monde. En 1978, les Chiliens manquent de peu d’entrer en guerre contre la dictature militaire au pouvoir en Argentine, pour la possession de quelques petites îles australes dans le canal de Beagle, au sud de la Terre de feu. Le conflit ne sera vraiment résolu qu’en 1984, après la chute des militaires argentins : le traité signé sous l’égide du Vatican attribue les îles au Chili, mais une grande partie des droits maritimes à l’Argentine ; il inclut également une délimitation du détroit de Magellan.
La dictature entreprend aussi de remplacer la Constitution de 1925, considérée comme la source de tous les maux du pays. La nouvelle loi fondamentale, qui établit notamment un second tour pour les élections présidentielles, est approuvée en 1980 par un référendum dont l’organisation est controversée. Comme le prévoit le texte constitutionnel, Pinochet est reconduit au pouvoir pour huit ans.
Mais lorsque Pinochet demande la prolongation de son mandat présidentiel, en 1988, le « oui » n’obtient que 44 %. Le dictateur est alors contraint d’organiser une transition progressive vers la démocratie, tout en se ménageant une immunité (et en gardant la direction de l’armée). En mars 1990, il cède son poste de Président de la république au démocrate chrétien Patricio Aylwin, victorieux d’élections démocratiques élu à la tête d’une coalition — la Concertación — qui associe le PDC, deux formations de centre-gauche et les socialistes. Ceux-ci retrouvent la présidence en 2000, puis en janvier 2006 avec Michelle Bachelet, première femme élue à ce poste dans le pays. En décembre suivant, Pinochet décède sans avoir véritablement été inquiété : son immunité de sénateur à vie avait été levée en 2004 pour son implication dans l’opération Condor, mais il avait été relaxé l’année suivante, les plaintes déposées par les familles de victimes ayant été jugées irrecevables.
Les élections suivantes voient se succéder des présidents de la Concertación (Bachelet réélue en 2013) et de la Coalition pour le changement (droite et centre-droit). En 2018, le gouvernement de Santiago accède à une partie des revendications, parfois violentes, des Rapa Nui (un peu moins de la moitié des habitants de l’île de Pâques) qui dénoncent les méfaits du sur-tourisme et réclament un meilleur partage des fruits du développement économique : la durée de séjour des touristes est limitée à trente jours et celle des travailleurs non autochtones à un an. L’année suivante, la coalition de droite doit affronter d’importantes manifestations, causées par l’augmentation des tarifs des transports dans la capitale. Malgré l’abandon du projet, les manifestants continuent à protester, contre les inégalités (25 % de la richesse détenus par 1 % de la population) et contre un système social (éducation, santé, retraite) qui, étant issu de l’ultralibéralisme économique des années Pinochet, fait la part belle au secteur privé, alors que les conditions ont changé : l’ancien bon élève de l’Amérique du sud a été rattrapé par la crise qui a frappé l’ensemble de la planète à la fin des années 2000. Des émeutes étant survenues dans plusieurs villes (et ayant fait une quinzaine de morts), le gouvernement ordonne le déploiement de l’armée dans les rues de la capitale (du jamais vu depuis la chute de la dictature) et proclame l’état d’urgence.
En 2020, le président de centre-droit Sebastián Piñera (Rénovation nationale) — qui a échappé à deux procédures de destitution pour malversation — se voit contraint d’organiser un référendum pour rédiger une nouvelle Constitution. Adopté par 78 % des votants, le projet de remplacer la Loi fondamentale instaurée par Pinochet est suivi de l’élection d’une Assemblée constituante, entièrement constituée de citoyens (et présidée par une universitaire Mapuche). A la fin de l’année 2021, l’élection présidentielle voit l’élimination, dès le premier tour, des coalitions traditionnelles de centre-droit et de centre-gauche. Le scrutin est remporté par un ancien leader étudiant, candidat d’une alliance de gauche incluant les communistes, devant un conservateur catholique et pro-Pinochet. Mais les projets réformateurs du Président Gabriel Boric en matière fiscale et sociale se heurtent à son absence de majorité dans un Parlement très fragmenté. La fragilité de la gauche est d’ailleurs illustrée par le rejet (à plus de 60 %) de la nouvelle Constitution, qui était proposée aux électeurs en septembre 2022. Très progressiste en matière de droits sociaux, culturels et environnementaux, elle instaurait notamment le droit à l’avortement et surtout la création d’un État plurinational, conférant des droits d’autonomie aux « nations » indigènes ; cette perspective est rejetée aussi bien par ceux qui redoutent une fragmentation du pays que par les autochtones, inquiets d’être encore plus marginalisés.
C’est notamment le cas des Mapuches qui, depuis le début des années 2000, se sont radicalisés avec l’apparition d’un groupuscule, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), qui multiplie les occupations de terre et les sabotages, parfois meurtriers, d’engins forestiers, d’églises et d’entreprises. Arguant que ces radicaux seraient aidés par les narcotrafiquants et guérilleros colombiens, le gouvernement réactive une législation anti-terroriste datant des années Pinochet et instaure l’état d’exception dans deux provinces du pays Mapuche, l’Arauco et une partie du Biobio. Il est reconduit, contre ses convictions et ses intérêts électoraux, par le gouvernement de gauche, du fait de la recrudescence des incidents : près d’une attaque quotidienne sur les routes.
En mai 2023, une nouvelle Constituante est élue avec un profil plus politique que sa devancière : elle est largement dominée par le Parti républicain (extrême-droite) et Chili sans danger (droite). Mais le texte que ces deux groupes proposent aux électeurs ne rencontre pas plus de succès que le précédent : il est rejeté par 56 % des votants en décembre 2023. A la suite de ces différents scrutins, Boric se recentre : ouvrant son gouvernement aux socialistes, il met également en œuvre un contrôle plus strict de l’immigration et un renforcement des patrouilles policières, alors que le pays connaît une forte augmentation de la délinquance. Près de 9 % de la population chilienne est étrangère, soit un quasi-doublement en sept ans : du fait des incitations lancées par le Président Piñera durant son mandat, afin d’affaiblir le régime de Caracas, plus de 40 % des immigrés sont des Vénézuéliens, ce qui a favorisé l’implantation du groupe criminel Tren de Aragua au Chili. La violence ne faiblit pas non plus en pays Mapuche : trois carabiniers sont victimes d’un guet-apens mortel dans la province d’Arauco, en avril 2024.
Les questions de sécurité et d’immigration jouent un rôle majeur lors des élection générales qui se déroulent en novembre 2025, avec la réinstauration du vote obligatoire. Unie derrière une ancienne ministre communiste, la coalition au pouvoir affronte sept candidats, dont quatre représentant la droite extrême et modérée. Au premier tour, la candidate de gauche arrive en tête avec un peu moins de 27 % des suffrages, mais son réservoir de voix pour le second est faible : les représentants de l’opposition de droite réunissent 70 %, dont 24 % pour José Antonio Kast, fils d’un ancien soldat nazi et frère d’un ex-ministre de Pinochet, qui concourait pour la troisième fois (sous les couleurs du Parti républicain) ; la candidate de la droite traditionnelle (alliance Chili grand et uni) n’arrive qu’en cinquième position, avec moins de 13 % des voix, derrière le fondateur du Parti national libertarien (PNL) et celui du Parti du peuple (Partido de la Gente, PdG), un économiste populiste qui s’était déjà classé troisième en 2021 et arrive en tête dans les régions du Nord, les plus concernées par l’arrivée de migrants. L’ultra-conservateur Kast est élu au second tour avec plus de 58 % des voix. Mais, bien que sa coalition Changement pour le Chili (formée avec le PNL) ait presque triplé son nombre de députés, il n’a pas de majorité propre et devra composer avec les autres formations de droite, laquelle domine désormais la Chambre des députés et le Sénat ; la coalition de gauche et du centre (Unité pour le Chili) y détient encore le plus grand nombre d’élus, mais loin de la majorité, après avoir réalisé son pire score depuis le retour de la démocratie.
En janvier 2026, Kast compose son gouvernement avec une grande majorité d’indépendants, non membres des partis qui l’ont soutenu : il compte même deux anciens ministres de la socialiste Bachelet. La plupart des personnes investies n’en représentent pas moins la droite radicale, à l’image de deux anciens avocats de Pinochet (nommés à la défense et à la justice) et d’une jeune enseignante évangélique (titulaire du ministère de la femme et de l’équité entre les sexes).
