L’appellation Euskal Herria, littéralement « les terres où on parle l’euskara » (ou euskal, la langue basque) n’apparaît qu’au XVIe siècle : elle désigne des territoires situés de part et d’autre des Pyrénées occidentales et passés, depuis le IXe siècle, d’une dépendance à l’autre (le duché Vascon des Wisigoths, les royaumes de Pampelune et de Navarre…).
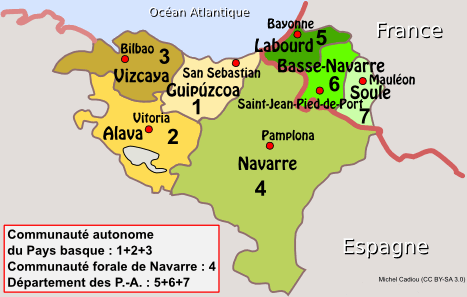
Seule langue non-indoeuropéenne d’Europe (encore vivante) à avoir échappé à la romanisation, le basque est aujourd’hui parlé par environ 1,1 million de personnes (sur plus de 3 millions concernées) dans le nord de la Navarre, une partie des Pyrénées atlantiques françaises et surtout dans les trois provinces de la Communauté autonome du Pays basque (un peu plus de 7 000 km²) : le centre et l’est de la Biscaye (capitale Bilbao, dans laquelle se situe l’enclave cantabrique de Valle de Verde), le Guipúzcoa (capitale San Sebastian) et le nord de l’Alava (capitale Vitoria, dans laquelle la province de Burgos possède l’enclave en partie bascophone de Treviño). La langue basque est également parlée par environ 4,5 millions de personnes dans la diaspora. Pour en savoir plus.
Les deux versants basques des Pyrénées se sont séparés au début du XVIe siècle. Craignant que les Français ne mettent la main sur le royaume de Navarre (qui déborde alors au nord du massif pyrénéen), la Castille s’en est emparée en 1512. Mais, pour éviter des frictions inutiles avec la France, qui a lancé une contre-attaque, les Castillans n’ont conservé que la Haute-Navarre, c’est-à-dire les terres situées au sud des Pyrénées et du col de Roncevaux. La Basse-Navarre, le Labourd (Bayonne) et la Soule sont devenues propriété du royaume de France entre 1450 et 1620. A la Révolution française, ils ont été fondus avec le Béarn dans le département des Pyrénées-atlantiques.
A la fin du XIXe siècle, Sabino Arana y Goiri développe une théorie selon laquelle les habitants de la Biscaye doivent se libérer de la tutelle castillane, théorie qui gagne les autres régions parlant euskara. Jugeant que le nom Euskal Herria n’est pas adéquat pour désigner politiquement le pays des Basques, il crée le néologisme Euskadi, invente un drapeau national (l’ikurriña, inspiré de l’Union Jack britannique) et fonde en 1895 le Parti nationaliste basque (PNV, EAJ en basque), formation séparatiste et catholique, dont la devise est « Dieu et les vieilles lois » : il s’agit en l’occurrence des fueros, textes coutumiers que le roi d’Espagne se devait de respecter, mais qui ont été supprimés après les guerres carlistes de 1833-1839 et 1874-1876 (cf. La formation des pays ibériques). Le PNV a pour objectif de réunir dans un Etat-nation les sept territoires dans lesquels l’euskara est parlé, surtout dans le monde rural : la Biscaye, le Guipúzcoa, l’Alava et la Navarre côté espagnol (Higoalde), la Basse-Navarre, le Labourd et la Soule jusqu’à Bayonne côté français (Iparralde).
Dans les années 1950, des jeunes du PNV s’insurgent contre l’immobilisme relatif de leur parti – alors que le régime franquiste réprime toute manifestation de la culture basque – et préconisent le passage à la lutte armée. La rupture est consommée en 1959, date de naissance de l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pays basque et liberté). Le premier assassinat, celui d’un policier, a lieu en 1968, deux mois après que la Guardia civile a tué le premier etarra (combattant). Les premières condamnations à mort d’activistes de l’ETA sont prononcées en décembre 1970. Trois ans plus tard, le mouvement devient célèbre dans le monde entier avec l’assassinat en plein cœur de Madrid de l’amiral Carrero Blanco, chef du gouvernement espagnol et successeur présumé de Franco. Les méthodes de lutte de l’organisation, ainsi que son orientation marxiste-léniniste, ne font pourtant pas l’unanimité en son sein : en 1974, elle se scinde entre l’ETA militaire (entièrement tournée vers la lutte armée) et l’ETA politico-militaire (« PM »poli-mili », qui préconise la combinaison d’une guérilla sélective et d’actions politiques de masse).
La mort de Franco, en 1975, ne change rien à la stratégie des etarras, qui multiplient les meurtres : 123 en 1980, une année record. Pourtant, l’année précédente, les députés espagnols ont voté, à une écrasante majorité, le statut de Guernica qui a rétabli les fueros et accordé à la Communauté autonome du Pays basque la plus large autonomie jamais accordée à une région espagnole (avec une capitale fixée à Vitoria). Mais c’est trop peu pour l’ETA et pour son bras politique, Herri Batasuna (HB, Unité populaire, fondé en 1978) qui continuent à exiger un État indépendant incluant l’Euskadi-nord ou Irrapalde (les trois provinces de France) et la Navarre. Celle-ci a en effet préféré faire cavalier seul et bénéficier de sa propre Communauté autonome forale (en 1982) : ne se considérant pas comme Basques, la majorité des Navarrais ont voté pour des partis espagnols ou pour une nouvelle formation conservatrice locale, l’Union du peuple navarrais (UPN).
Tandis que les « poli-mili » se sabordent, en 1983, l’ETA continue sa fuite en avant, faite de meurtres (en particuliers de membres de l’Ertzaintza, la police régionale créée en 1982), de violences de rues (contre des bâtiments représentant le pouvoir madrilène), d’enlèvements contre rançon et d’extorsion de fonds (« l’impôt révolutionnaire » qui est même exigé des commerçants, artisans, professions libérales). Le pouvoir espagnol, alors dirigé par les socialistes, réagit en reprenant une stratégie déjà mise en œuvre par Franco : la création de commandos contre-terroristes. De 1983 à 1987, les Groupes anti-terroristes de libération (GAL) exécutent une vingtaine de personnes, essentiellement en France, devenue la principale base arrière de l’ETA. Cette stratégie vaudra à deux ministres socialistes et à plusieurs hauts fonctionnaires de police d’être incarcérés et poussera les etarras à commettre leur pire attentat : une vingtaine de morts dans un supermarché barcelonais en juin 1987.
La suite n’est qu’une succession de trêves unilatérales de l’ETA, rompues plus ou moins rapidement (notamment avec des tentatives d’assassinat du chef du gouvernement et du roi d’Espagne en 1995). Achetant des armes auprès de filières moyen-orientales, l’organisation coopère également avec la guérilla colombienne des FARC : facilitée par le Venezuela, cette collaboration se serait notamment concrétisée par des stages de fabrication d’explosifs et de maniement de missiles sol-air dans les jungles colombienne et vénézuélienne. Le pouvoir répond par la répression des multiples structures liées au mouvement. Ses bases arrières en France sont démantelées, ses vitrines légales sans cesse dissoutes (et renouvelées), ses organisations de jeunesse traquées, ses « tavernes du peuple » fermées… En trente-cinq ans, 150 etarras ont été tués et plus de 8 000 emprisonnés, non sans conséquence : soumis à des conditions drastiques de détention (jusqu’aux Canaries et à Ceuta et Melilla), de nombreux prisonniers émettent des doutes sur la pertinence de poursuivre une lutte armée qui a fait 800 morts. Même des détenus historiques prennent leurs distances, estimant que « la violence n’a pas de sens » dans un Pays Basque où « les revendications peuvent se faire jour à travers les institutions démocratiques ». En 2001, Batasuna est d’ailleurs traversée par une scission : lassés de la violence de la gauche radicale, les modérés créent le mouvement Aralar, très présent en Navarre.
Pour essayer de sortir de l’impasse, le Président PNV de la Communauté basque propose, en 2002, un « projet de libre association et de souveraineté partagée entre le Pays basque et l’Espagne », créant la nationalité basque et dotant la région de pouvoirs élargis en matière sociale, fiscale et judiciaire. Rejetée en Alava (qui menace de quitter l’Euskadi) et par les successeurs de Batasuna, la proposition n’en est pas moins adoptée par le Parlement de Vitoria fin 2004, avec le soutien d’une partie des nationalistes radicaux… avant d’être massivement rejetée par le Congrès de Madrid en février suivant. Dans le pays, la contestation anti-ETA monte sous la forme de comités Basta Ya (« ça suffit »), dont un des animateurs est assassiné en 2003 par des etarras : ancien militant de l’ETA poli-mili, il était devenu chef de la police municipale d’Andoain. En 2009, le pouvoir dans la Communauté autonome basque échappe pour la première fois au PNV et passe aux mains de partis « espagnolistes » : la gouvernance sera exercée par les socialistes locaux avec le soutien, sans participation, des conservateurs du Parti populaire. Ce changement majeur intervient cinquante ans après la création de l’ETA, anniversaire que l’organisation « célèbre » en assassinant (à la voiture piégée) deux jeunes gardes civils à Majorque et en commettant un attentat contre une caserne de la garde civile à Bilbao (qui ne fait miraculeusement qu’une soixantaine de blessés, dont des femmes et des enfants de gardes logés dans ces bâtiments).
Affaiblie par les coups que lui ont portés les polices espagnole et française, l’aile militaire de l’ETA cède à la pression de sa vitrine politique. En janvier 2011, l’organisation annonce « un cessez le feu permanent » qui apparaît plus crédible que la dizaine de trêves annoncées par le passé, car il pourra « être vérifié par la communauté internationale ». Cette déclaration est toutefois jugée insuffisante par Madrid, dans la mesure elle ne parle ni de l’abandon de la lutte armée, ni de la renonciation à l’autodétermination. Après avoir renoncé à lever « l’impôt révolutionnaire », l’ETA annonce « l’arrêt définitif » de la lutte armée en octobre 2011. Ce nouvel élément provoque un sursaut des mouvements nationalistes qui laminent les socialistes, aux élections régionales de 2012 : de nouveau en tête, le PNV est suivi de la coalition Amaiur[1] formée par Aralar et Bildu, alliance de mouvements de la gauche abertzale (« patriotes ») tels que Eusko Alkartasuna (EA, « Solidarité basque », formée en 1986 par les sociaux-démocrates du PNV). Au printemps 2017, près de deux cents sympathisants de l’ETA remettent à la justice française le stock d’armes et d’explosifs de l’organisation qui, un an plus tard, annonce la dissolution de toutes ses structures, tout en considérant que « Euskal Herria (reste) en conflit avec l’Espagne et la France », ce qui interdit au pouvoir madrilène d’engager de véritables négociations.
Si l’enseignement du basque a progressé, les élections et les enquêtes d’opinion montrent en revanche un recul de la cause indépendantiste, passée d’environ 35 à 20 %. Aux législatives nationales anticipées de 2023, les partis et coalitions basques sont de nouveau devancés par les socialistes, avec lesquels le PNV gouverne la Communauté autonome depuis 2016 (comme il l’avait déjà fait entre 1987 et 1998). En revanche, les nationalistes de toutes obédiences restent majoritaires aux élections du parlement de Vitoria[2]. De son côté, la Navarre reste dirigée par l’UPN et ses alliés de la droite conservatrice, même si EH Bildu et un autre mouvement basque y ont obtenu plus de 30 % aux élections régionales de 2023. Dans le Pays basque français, 158 communes se sont regroupées en janvier 2017 dans une seule intercommunalité : la Communauté d’agglomération Pays Basque.
[1] Amaiur est l’endroit de la dernière bataille, en juillet 1522, entre les 200 derniers résistants Navarrais et les 10 000 hommes de l’armée Castillane.
[2] Les nationalistes recueillent entre 52 % et 68 % des suffrages (67 % en 2024), avec 28 à 42 % pour le PNV qui, après avoir devancé les vitrines politiques de l’ETA (plus de 18 % en 1990), domine désormais la gauche nationaliste modérée (32 % en 2024).